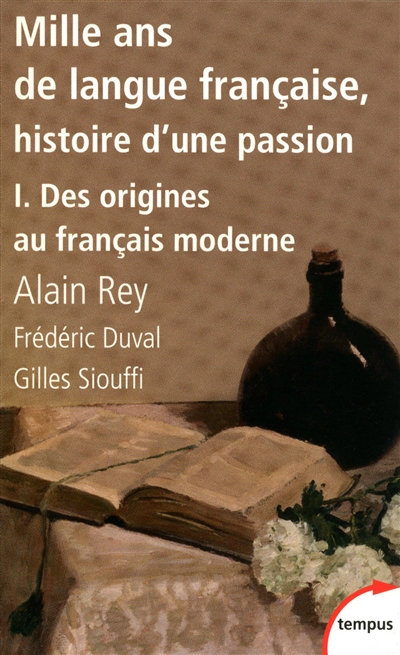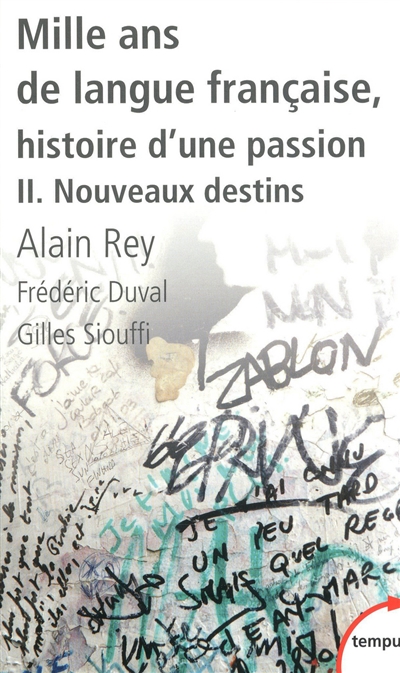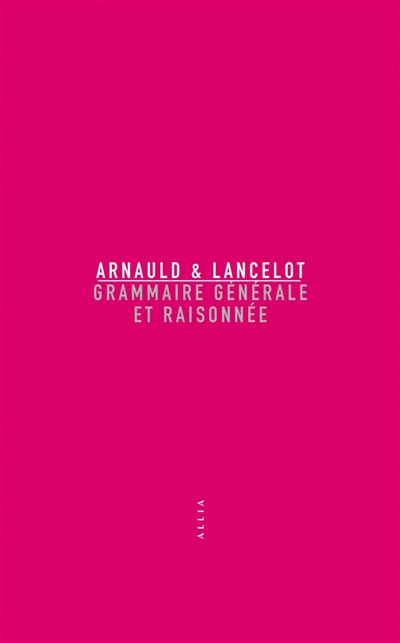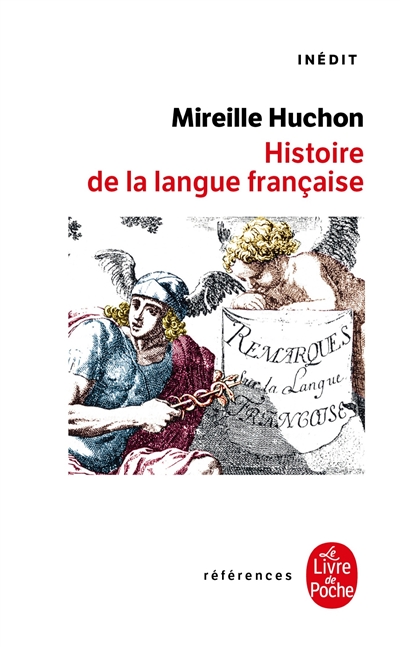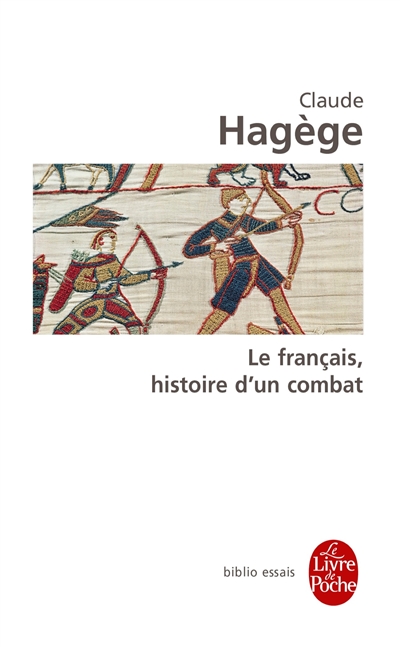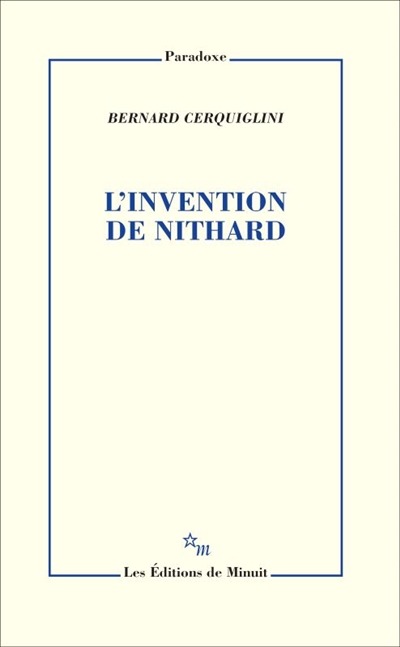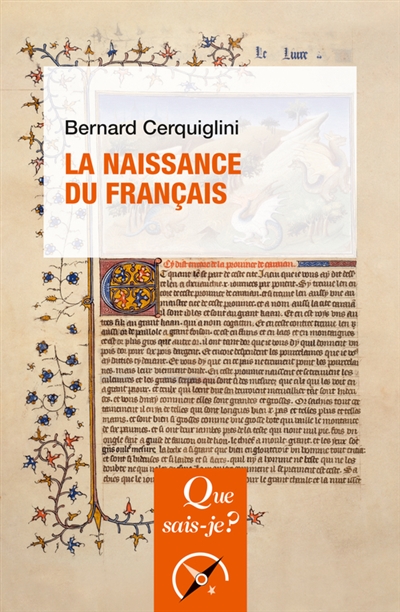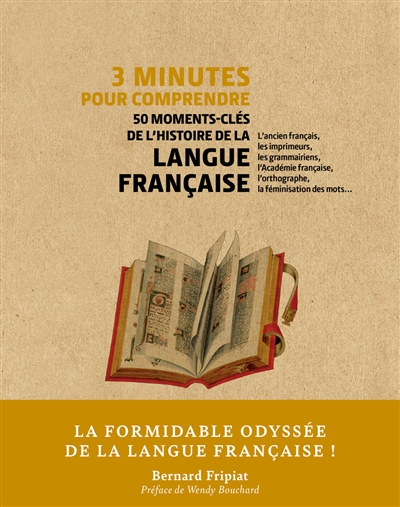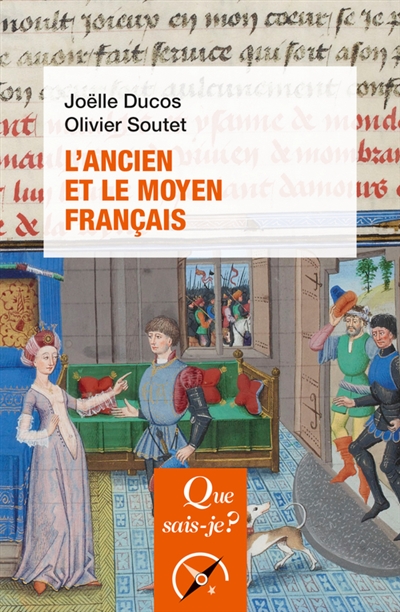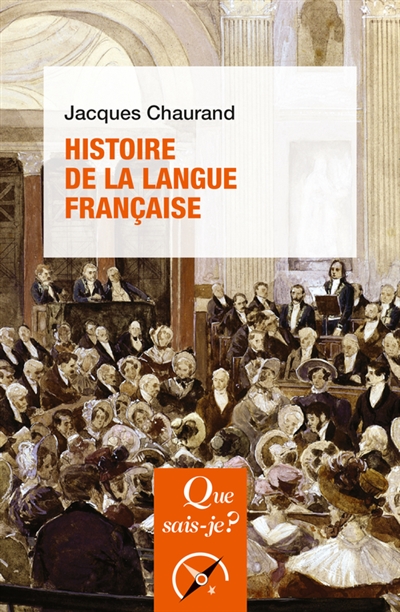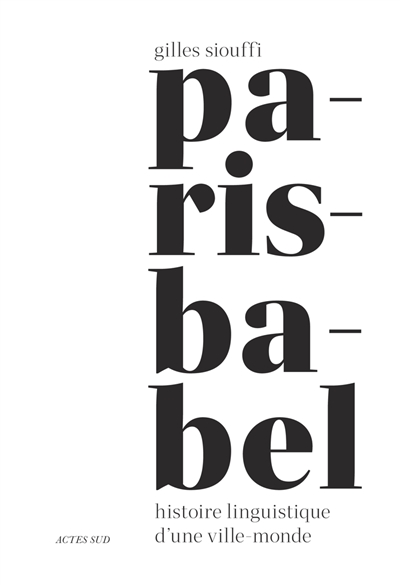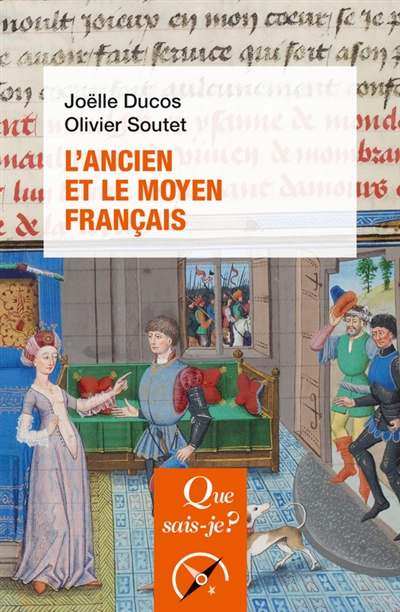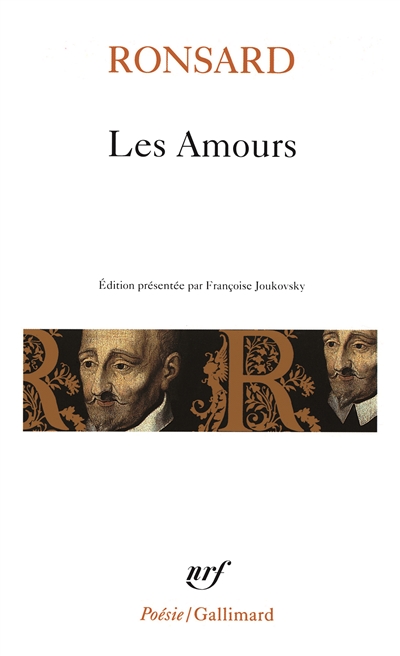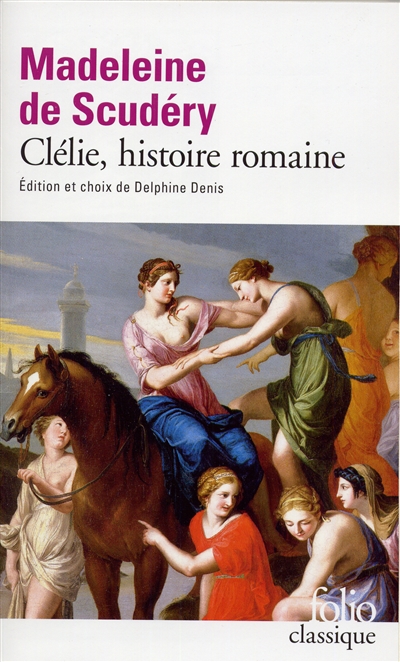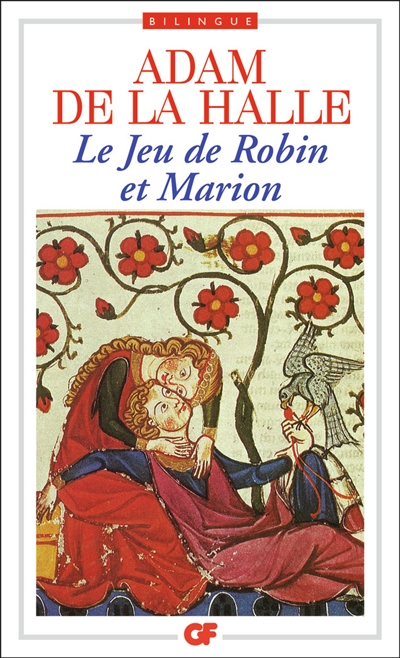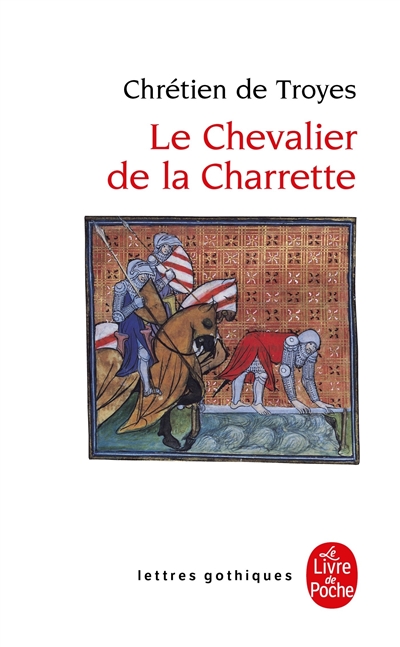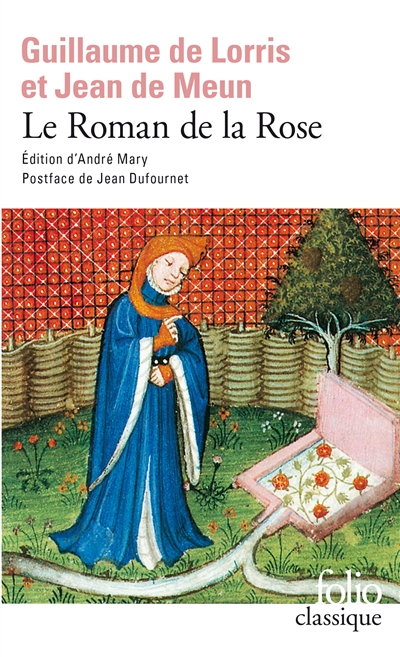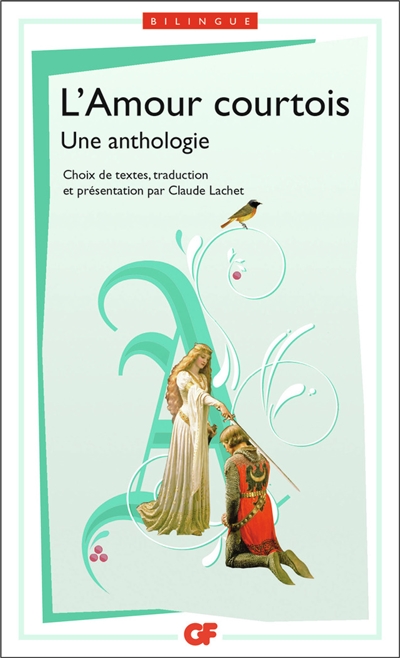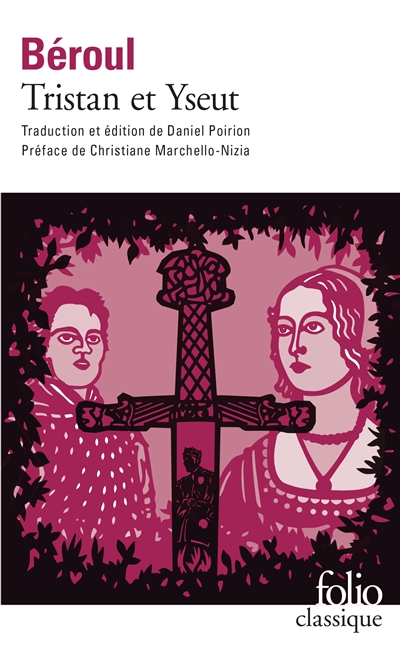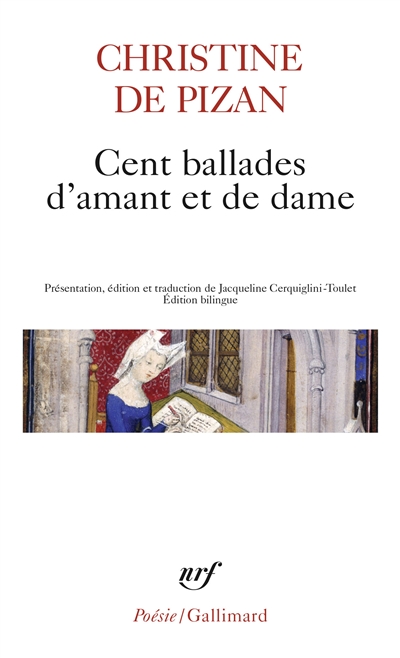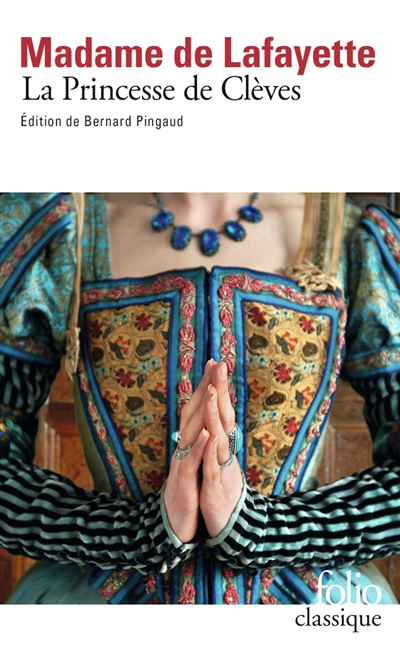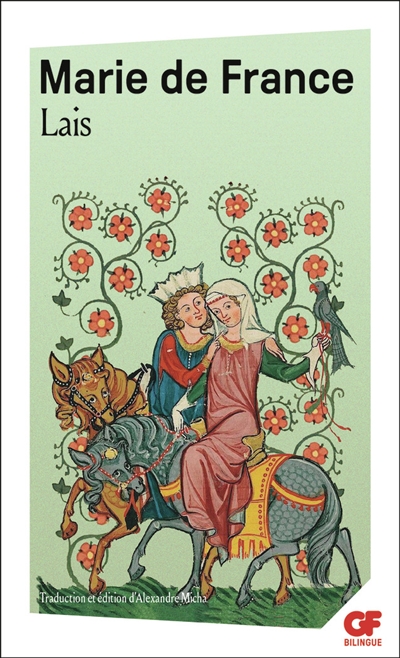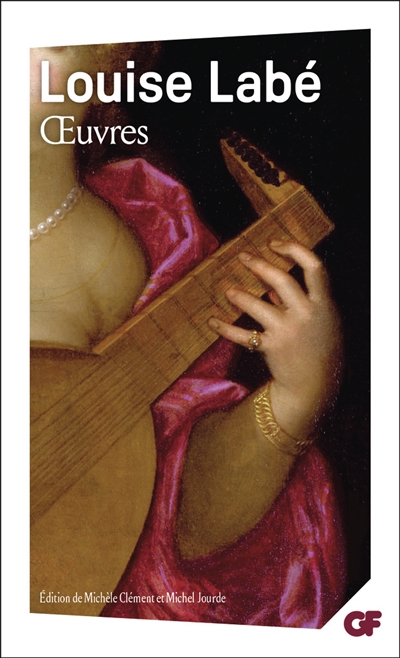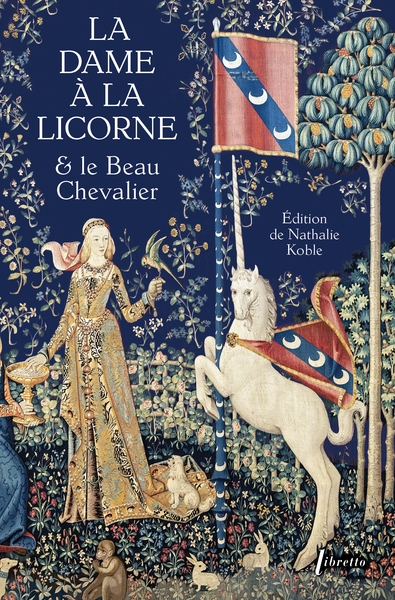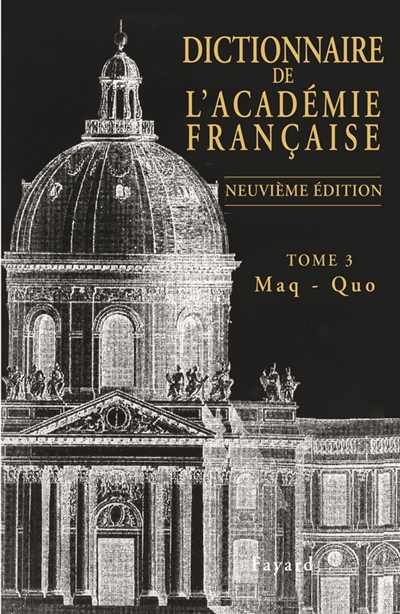Pour la Saint-Valentin, célébrons aussi l’anniversaire de la langue française
Le 14 février est le jour de l’amour. Les couples du monde entier se retrouveront ce vendredi pour célébrer leur rencontre, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule parfois, et leur union toujours recommencée.
Le sort a voulu que ce jour soit également la date anniversaire de la naissance du français. Il y a près de 1200 ans, en effet, les petits-fils de Charlemagne se jurèrent mutuelle assistance en s’exprimant chacun dans leur langue. Ce furent les Serments de Strasbourg, que leur cousin, Nithard, retranscrivit, en écrivant en français pour la première fois de notre histoire.
Le 14 février 842, un vendredi, à la fin de la matinée, sur le bord de l’Ill, dans un froid terrible, sur les lèvres des soldats francs, quand ils ont à proclamer leurs serments, une étrange brume se lève. On a appelé cette brume le "français". Nithard, le premier, a écrit le français.
Pascal Quignard, Les Larmes
Une fois couchée sur le papier, notre langue acquit un nouveau degré d’expression. Elle allait s’illustrer à travers un genre littéraire typiquement français : le roman d’amour. De Béroul à Christine de Pizan en passant par Chrétien de Troyes, nos poètes se mirent à chanter les premiers émois, les incertitudes du cœur et l'empire des passions. Toute l'Europe frémit à leurs contacts d'un sentiment nouveau, et qui sait combien d'amours véritables sont nés de ces lectures*. Elles exaltèrent tout spécialement les premiers grands écrivains italiens qui vinrent à leur tour, deux cents ans plus tard, enflammer l'inspiration des poètes de la Pléiade et raviver notre langue.
La Renaissance fut une période de grand renouveau du français. François Ier signa l’ordonnance de Villers-Cotterêts, qui imposa le français – c’est-à-dire le parisien –, comme langue officielle dans tout le royaume. Encore fallait-il la rendre digne de nos élites. Les poètes firent alors preuve d’une inventivité foisonnante pour enrichir notre langue et l'anoblir. Avec Rabelais, Ronsard et Du Bellay, les néologismes abondèrent, les phrases se tarabiscotèrent, et l’orthographe… ne suivit pas toujours. Pour éviter l’embrouillamini général, il fallait l’intervention d’un législateur.
Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,
Fit sentir dans les vers une juste cadence,
D’un mot mis en sa place enseigna le pouvoir,
Et réduisit la muse aux règles du devoir.
Nicolas Boileau, L’Art poétique
Malherbe inculqua au français les bonnes manières. Il débarrassa la langue des mots jugés trop précieux ou trop techniques et des tournures trop alambiquées. La prose dut désormais être simple, compréhensible par chaque Français, quelle que soient ses origines. C’est cette « doctrine Malherbe » qui commanda le travail de l’Académie française, fondée par Richelieu en 1634, et dont la tâche principale fut de fixer le bon usage de la langue sur tout le territoire. Le français devenu « classique » s’imposa alors dans toutes les cours européennes, puis partout dans le monde.
Au sortir de la Révolution, le français était ainsi parlé sur toute la surface du globe... excepté en France. Pour unifier la nation, l’abbé Grégoire prescrivit d'instruire tous les citoyens en langue française et d'interdire les langues régionales, parlées par les trois quarts de la population. Dans le même temps, les poètes romantiques cherchèrent à casser les codes du français classique. Le peuple gagnant en légitimité, ils mélangèrent les différents registres de langue en employant aussi bien des mots raffinés que des mots vulgaires, et reconduisirent ainsi la révolution dans la littérature.
Plus de mot sénateur ! plus de mot roturier !
Je fis une tempête au fond de l’encrier,
Et je mêlai, parmi les ombres débordées,
Au peuple noir des mots l’essaim blanc des idées ;
Victor Hugo, Réponse à un acte d’accusation
Vient le temps de la mondialisation. La domination culturelle des États-Unis impose sa langue dans toutes les relations internationales et de nombreux mots anglais entrent dans notre langage courant. La France défend son héritage par une série de mesures concrètes et symboliques. Les noms de métiers sont peu à peu féminisés, l'orthographe est simplifiée en 1990, l'utilisation du français est inscrite dans notre Constitution en 1992 et Emmanuel Macron inaugure la Cité internationale de la langue française, au château de Villers-Cotterêts, en 2023, comme un retour aux sources et une ouverture sur l'avenir de notre langue.
Depuis le serment de Strasbourg jusqu’au débat sur l'écriture inclusive, l'évolution de notre langue révèle une histoire faite de passion, de ruptures, de crispations, de tendresse, de revirements incessants. Une histoire bien tumultueuse, en somme... mais il paraît que les serments d’amour bénéficient de l’indulgence des dieux**.
*Dans la Divine comédie, Dante raconte comment Paolo et Francesca s’unirent grâce à la lecture d’un passage du Lancelot en prose, qui lui-même relate comment Lancelot s'éprit de Guenièvre par l’entremise d’un certain Galehaut. Pour Paolo et Francesca, « Galehaut fut le livre » nous dit Dante.
**Platon, Le banquet, 183 b