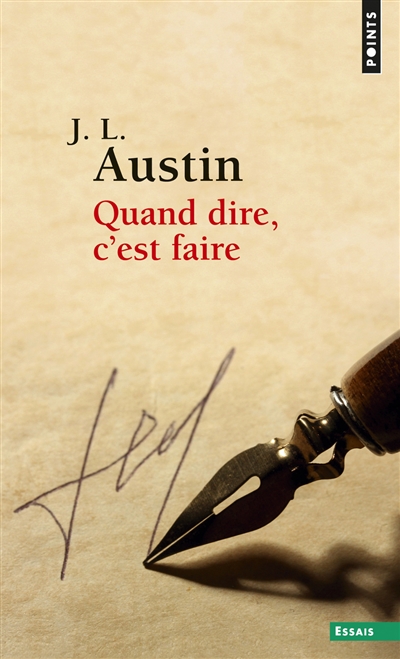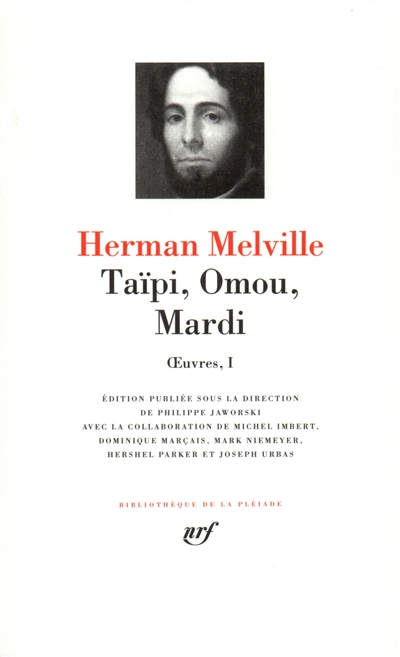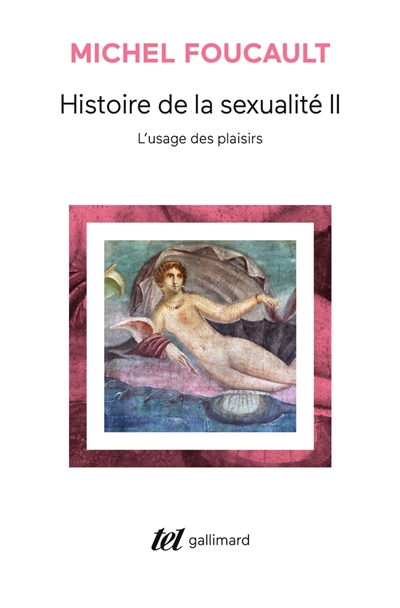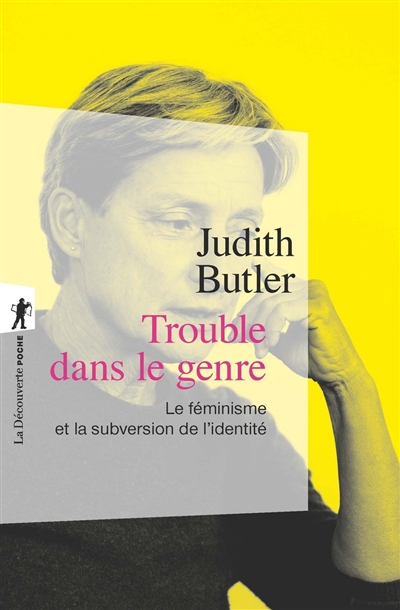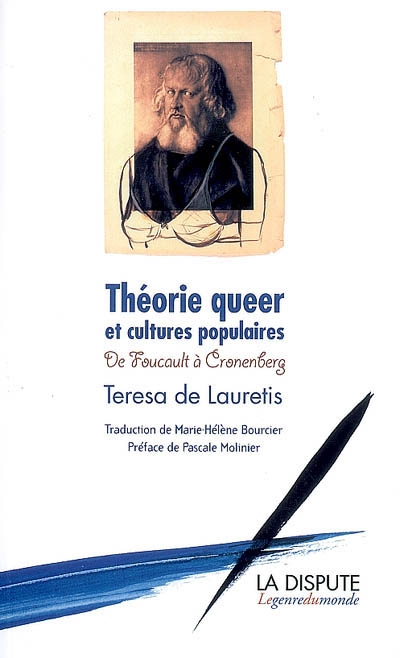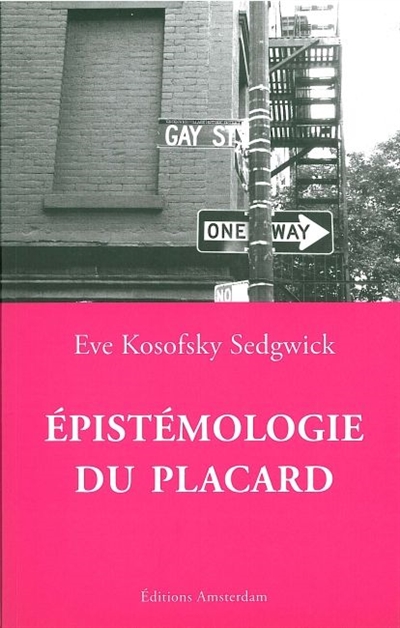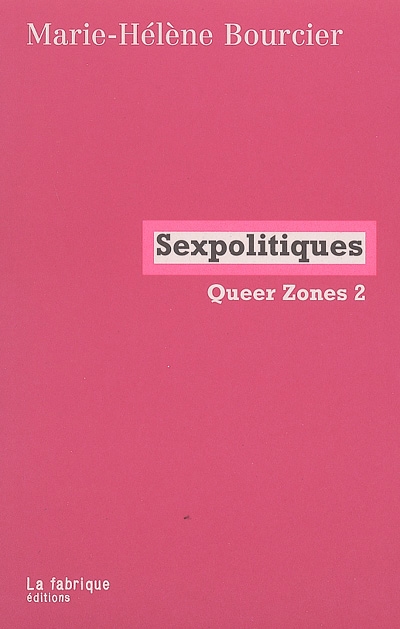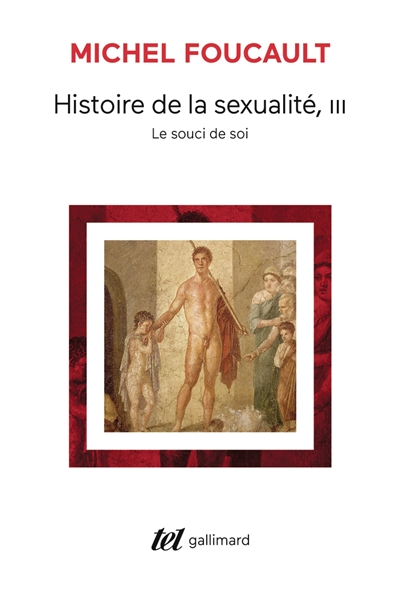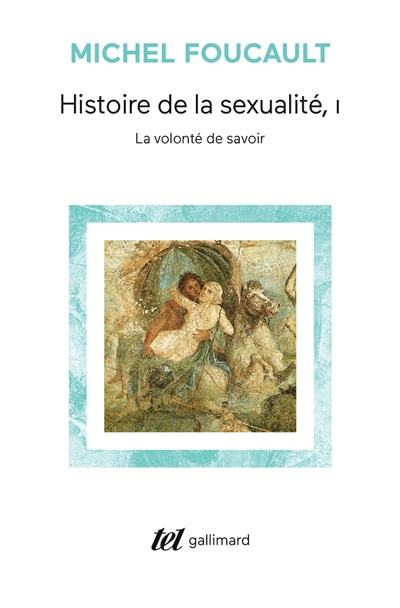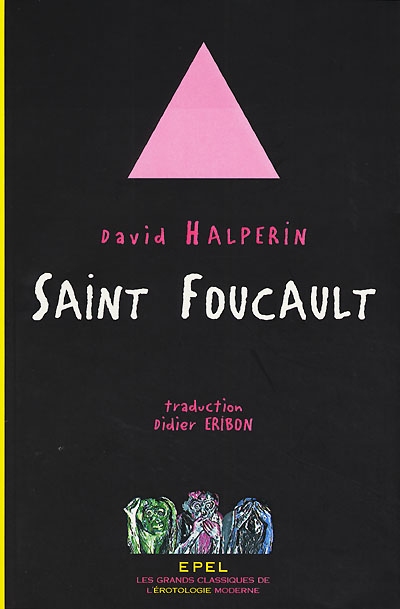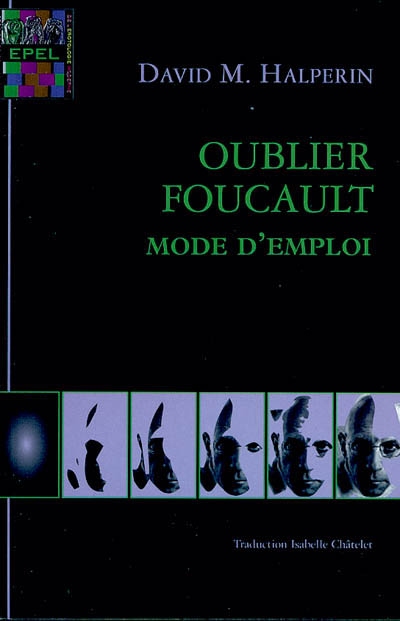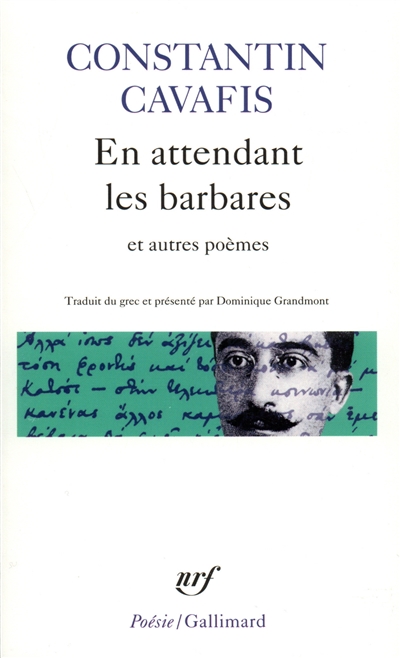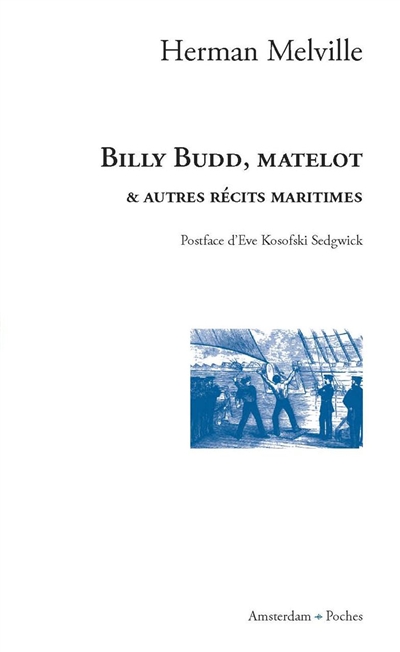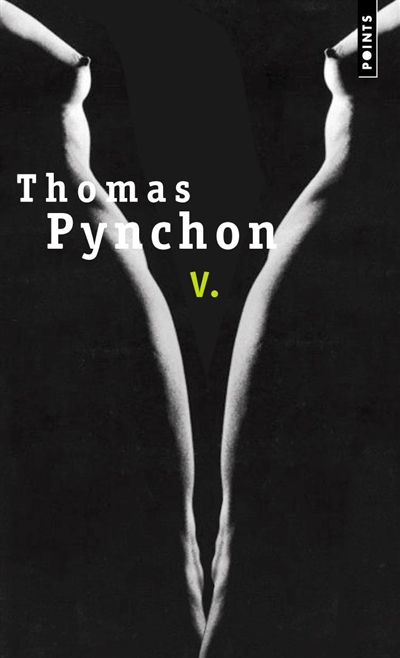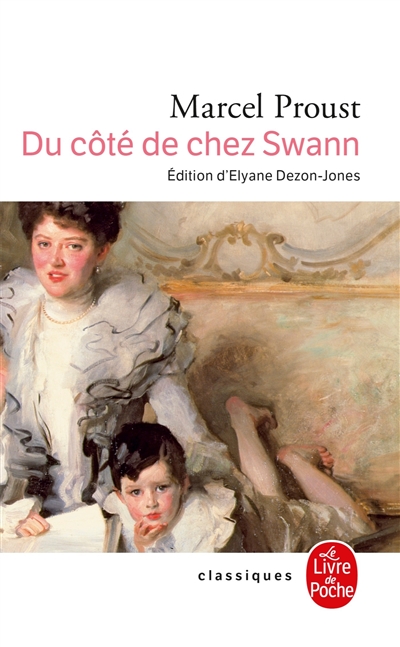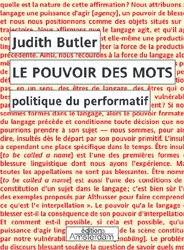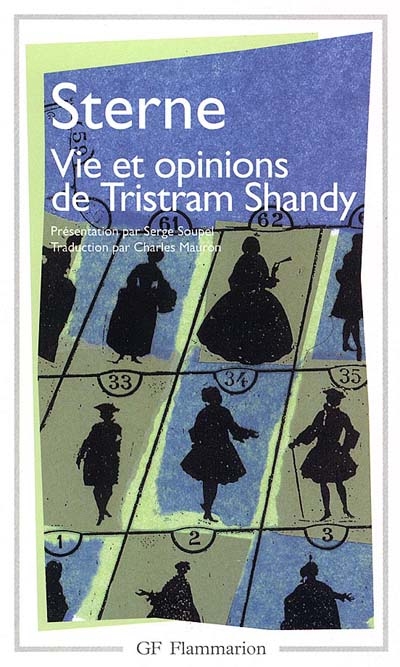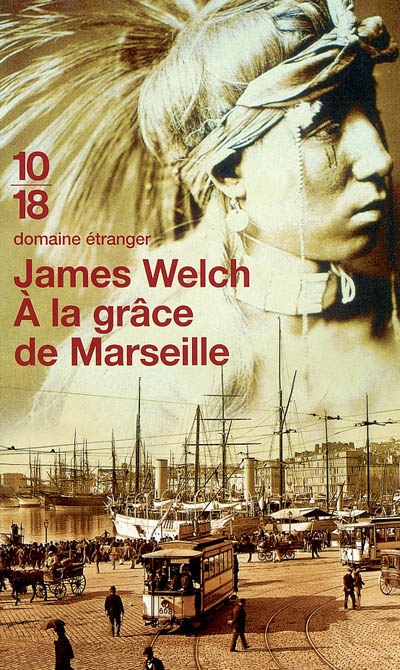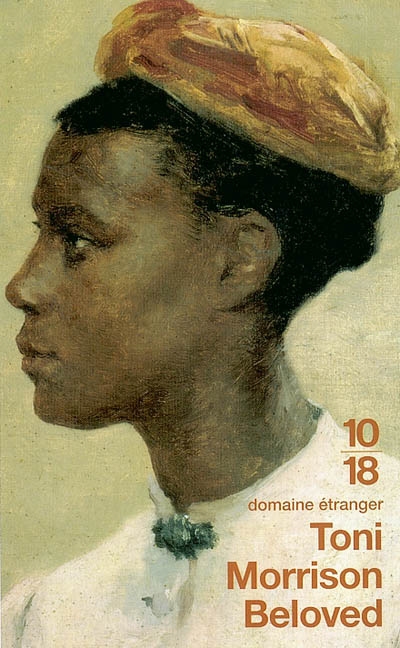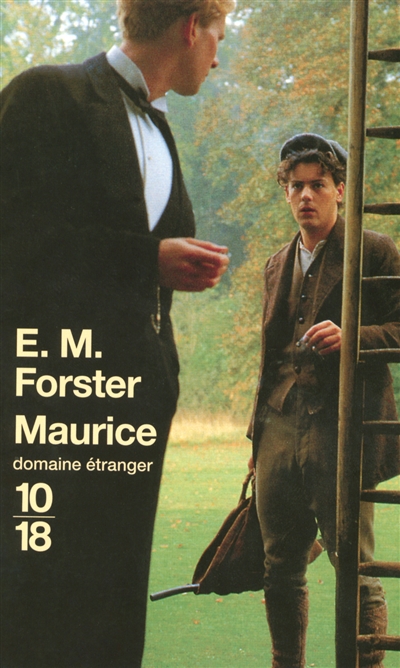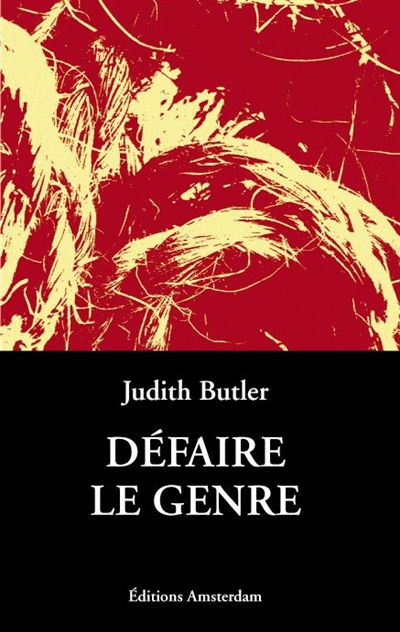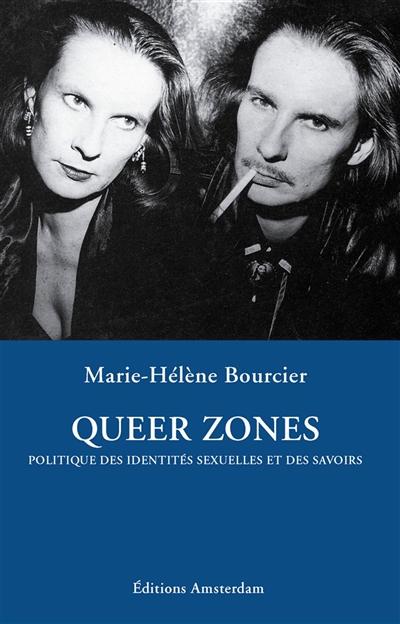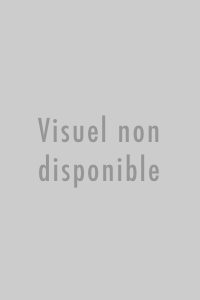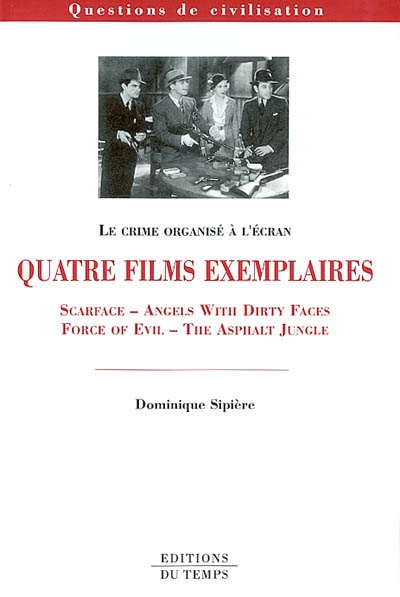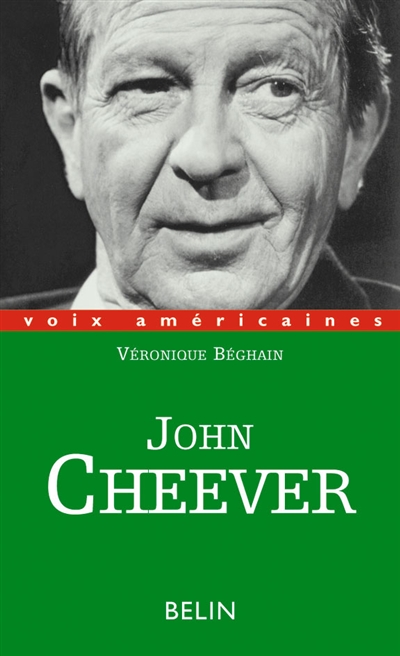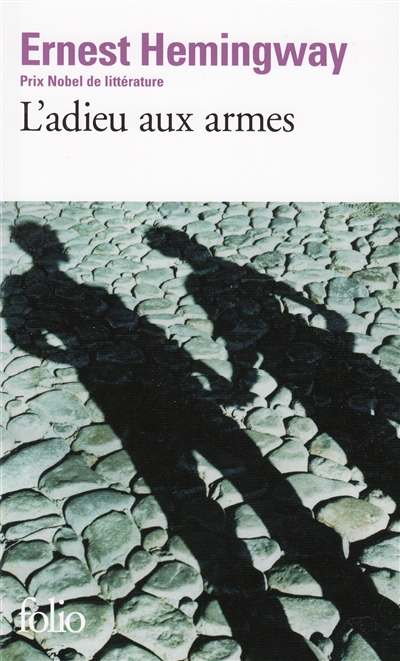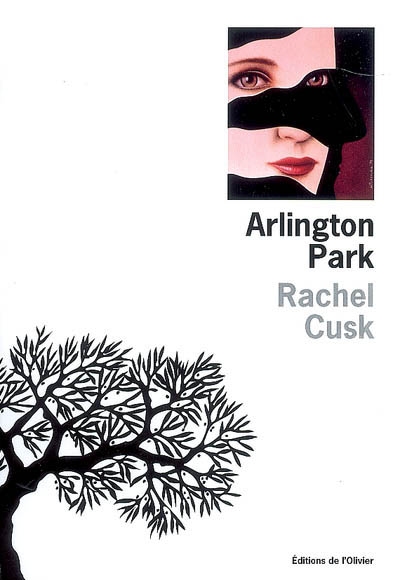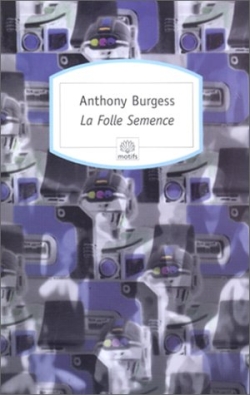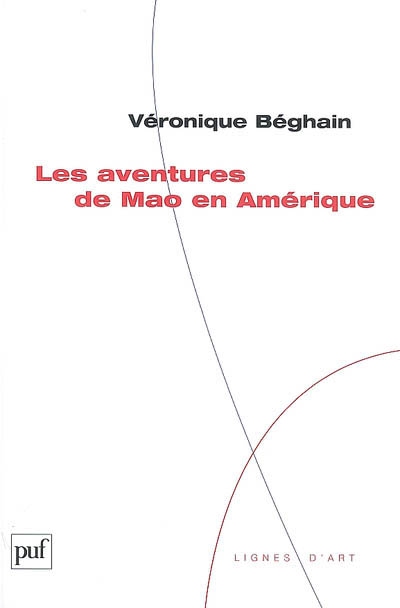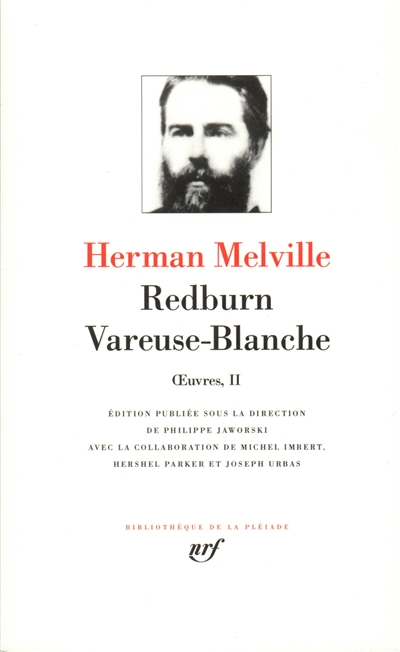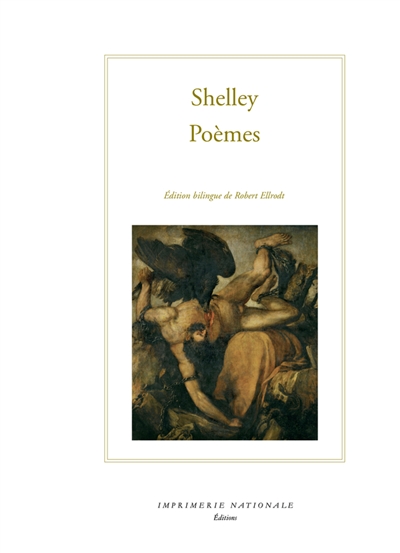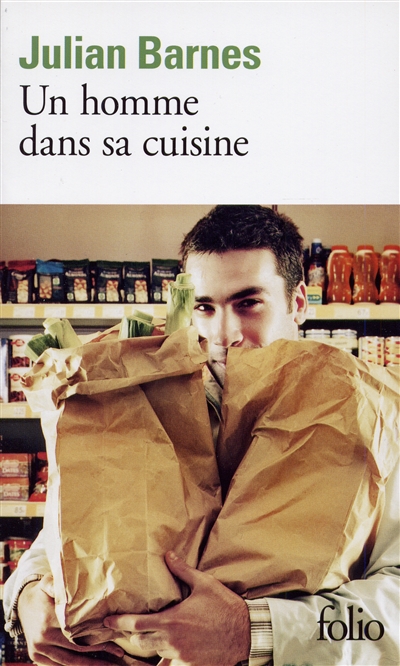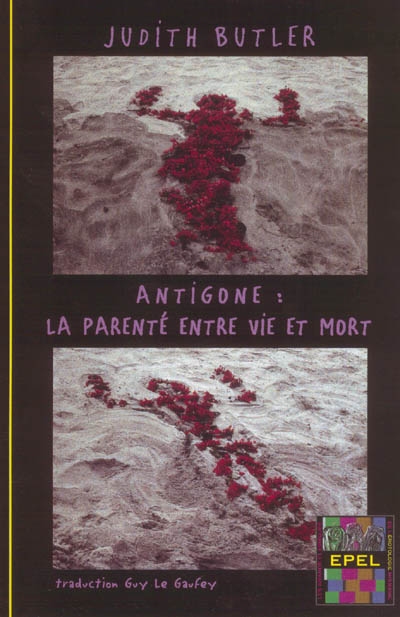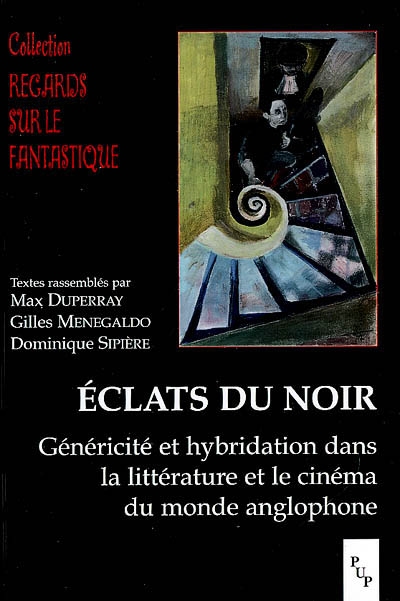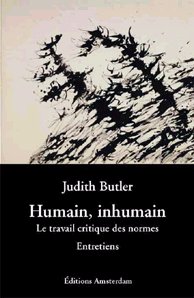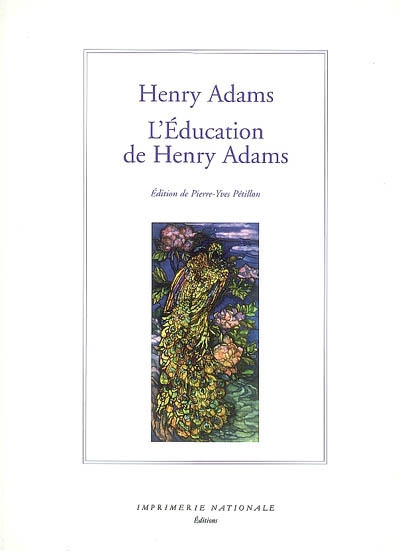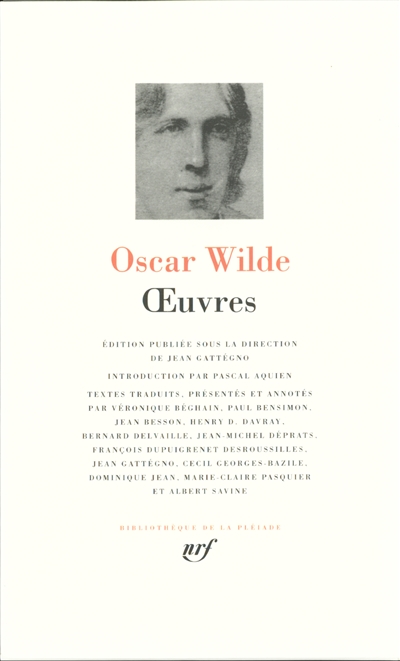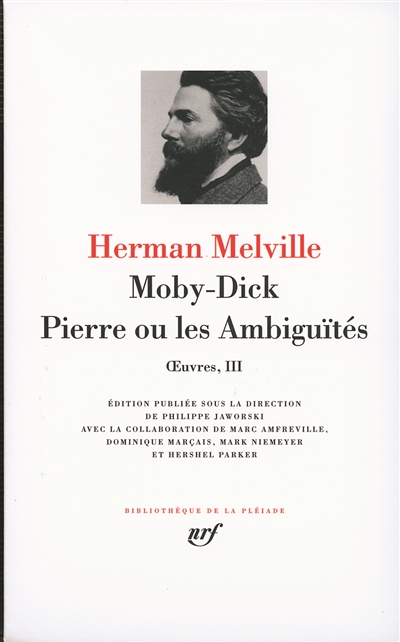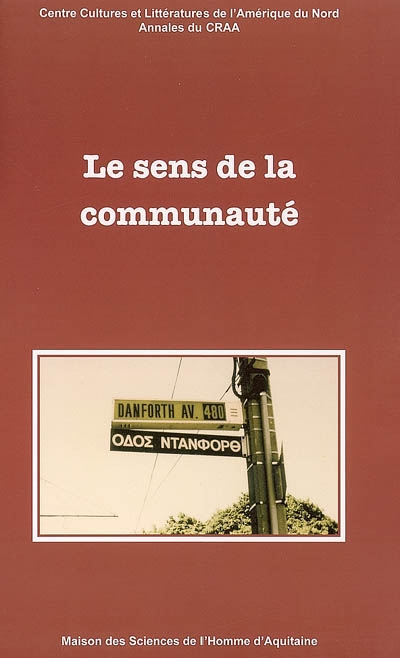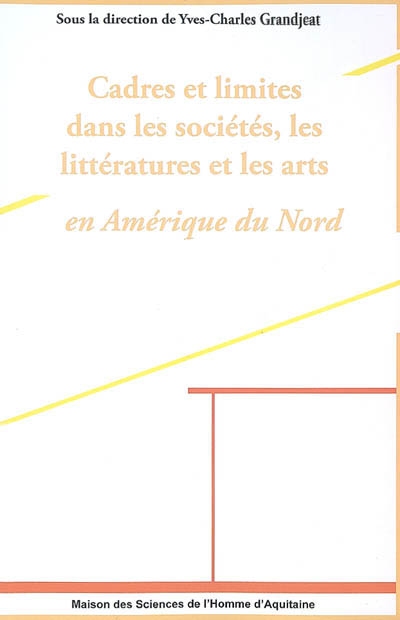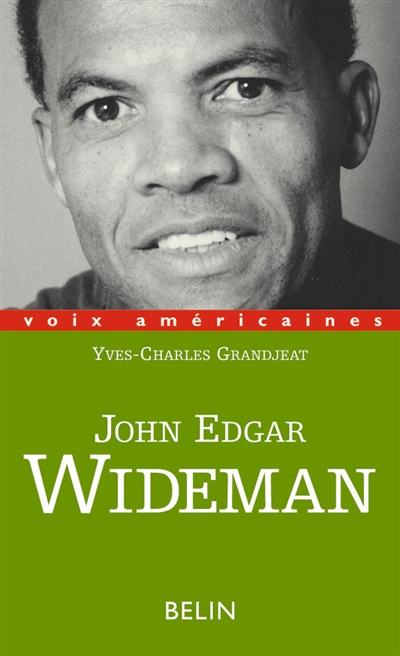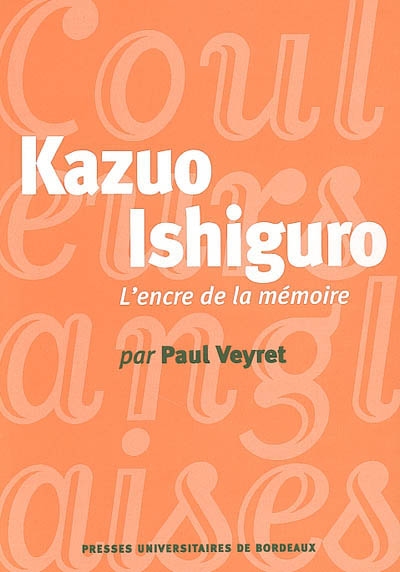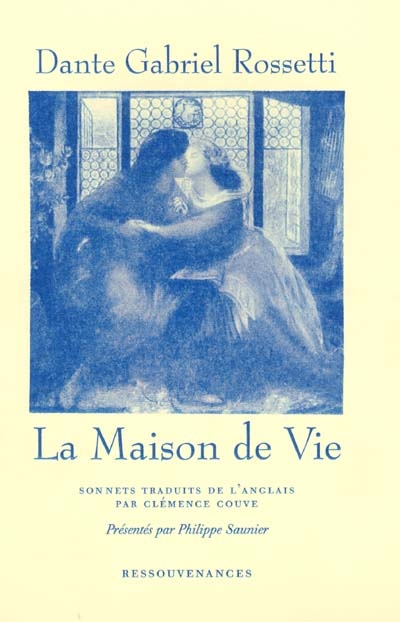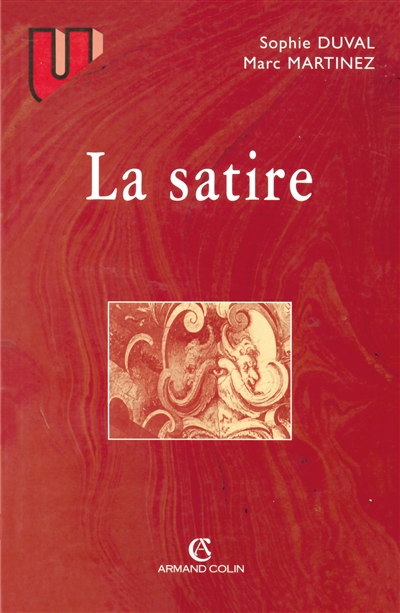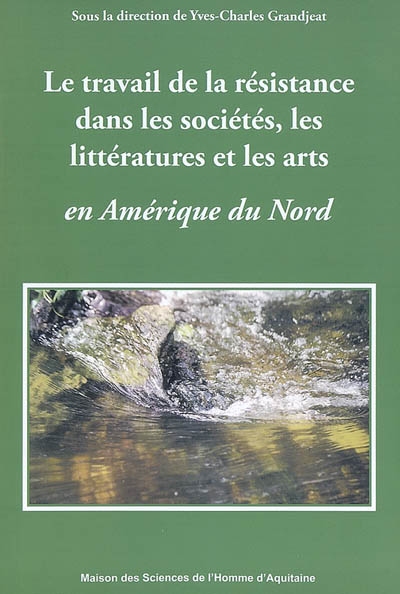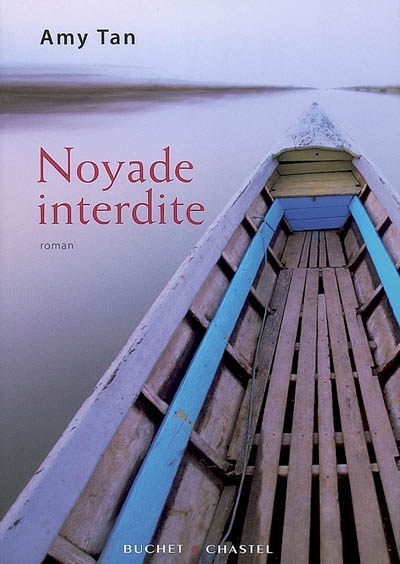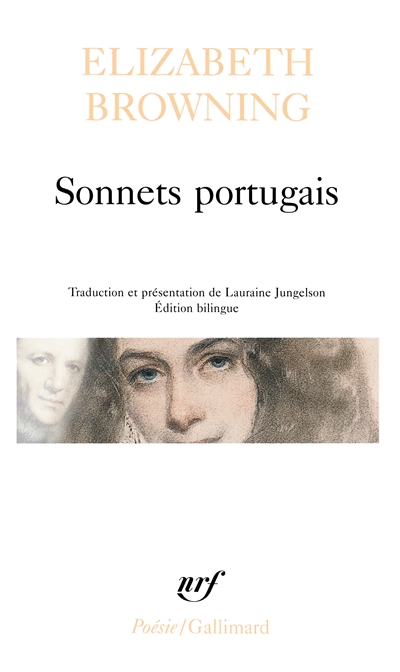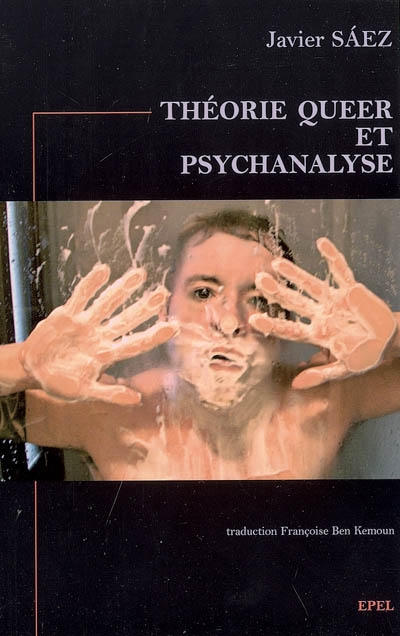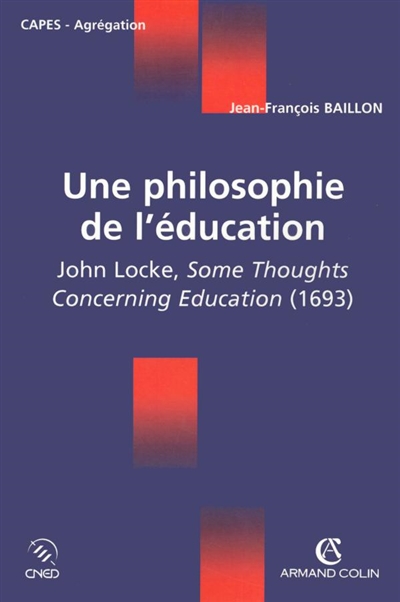La notion de réserve convoque avec elle tout ensemble creux et plein, manque et excès, absence et présence. Tandis qu'elle fait travailler les notions corollaires de réticence et de virtualité, mais aussi de surplus, elle affiche d'emblée son caractère réversible, constituant une mise en scène privilégiée de la limite, dont la capacité dynamique à jouer de l'actuel et du potentiel retient au premier chef l'attention. Au silence paradoxalement bavard de textes ou d'œuvres musicales répond, dans le domaine plastique, la circonscription du vide par la forme, cette « épargne » que constitue la réserve en art, ou encore le hors-champ cinématographique, qui met en œuvre un jeu de cache-cache à la bordure du cadre. Tandis que, selon Michel Foucault, il n'y a pas de « partage binaire entre ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas », la réserve, affichage de la lacune et de l'omission, entre le non-dit et le demi-mot, apparaît comme une figuration privilégiée, repérable sous la forme de l'indice, de ce qui peut être glosé en termes d'inconscient textuel, politique, notamment. La réserve, c'est enfin l'impensé de la critique, l'implicite idéologique qui sous-tend nos lectures et que, dans le meilleur des cas, nous cernons, sans pouvoir jamais véritablement en épuiser les strates ou les ramifications, de sorte que, dans cette perspective encore, la réserve se donne à voir comme l'effet d'une présence en creux ou d'un trop-plein sans lequel l'exercice de la pensée n'est paradoxalement pas concevable.
Eve Kosofsky Sedgwick, née en 1950 à Dayton dans l'Ohio, est l'auteur de travaux pionniers dans les champs connexes des « gender studies », « gay studies » et « queer studies ». Influencée par la pensée de Michel Foucault (notamment par son Histoire de la sexualité) et formée à l'école de la déconstruction derridienne, elle a élaboré, dès la fin des années 80, une pensée critique originale, nourrie aussi bien par l'analyse littéraire que par un intérêt marqué pour les questions liées à l'éducation, la sexualité, la maladie notamment.
Dans Between Men : English Literature and Male Homosocial Desire (1985), s'appuyant sur un corpus d'œuvres littéraires (Shakespeare, Sterne, Tennyson, Dickens, notamment), elle montre comment la mysoginie et l'homophobie sont deux formes d'oppression régulant l'« homosocialité », qui légitime quant à elle le désir des hommes entre eux et assure la domination masculine à l'intérieur du système patriarcal. Elle met en lumière, ce faisant, la proximité troublante des relations sociales et sexuelles entre hommes, soigneusement masquée par la division de la sexualité masculine entre hétérosexualité et homosexualité.
Epistémologie du placard s'attache à montrer comment notre rapport au savoir est étroitement lié à la « placardisation » de l'homosexualité masculine, la division moderne entre homosexualité et hétérosexualité devenant, à partir de la fin du 19ème siècle, structurante dans la construction de l'identité individuelle, de la vérité, du langage, aussi bien que de nos méthodes critiques. Ses travaux se situent au croisement de plusieurs champs et disciplines (philosophie, littérature, « gay studies », « queer studies », « gender studies », sciences de l'éducation), de sorte que sa pensée a essaimé dans toutes les disciplines, faisant d'elle, avec Judith Butler, l'une des théoriciennes majeures des études sur le genre et la sexualité.