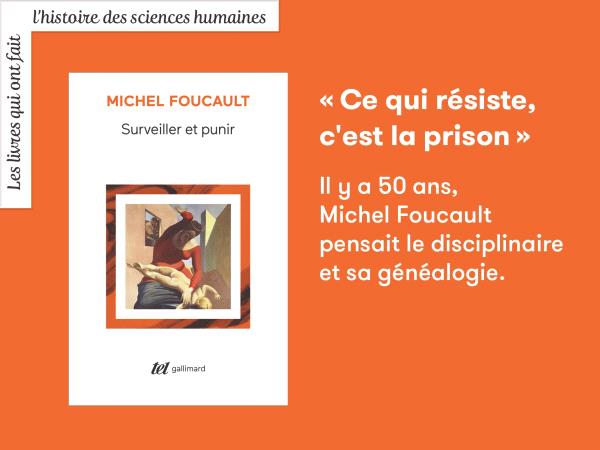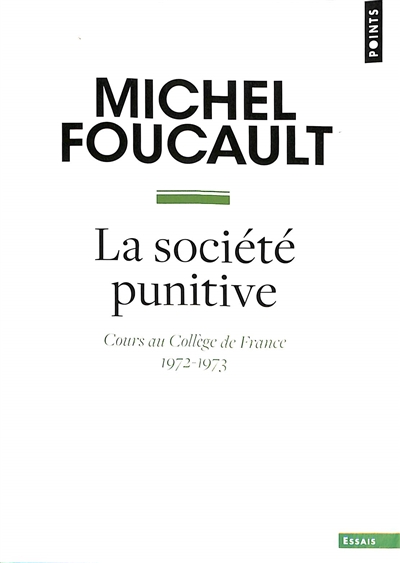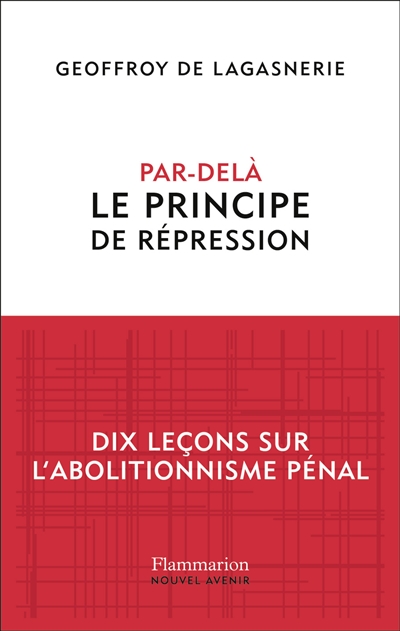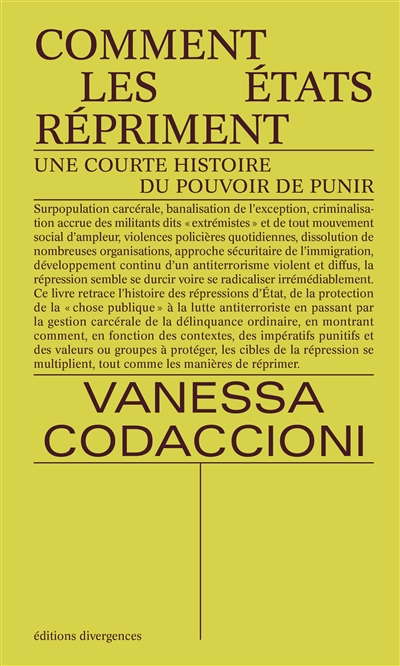A l'éboration du texte, Michel Foucault a déjà entamé son travail de recherche et d'engagement politique sur le système carcéral : en 1971, il fonde notamment le Groupe d'information sur les prisons (GIP), permettant aux détenus et aux acteurs des établissements pénitentiaires de visibiliser leurs problématiques auprès du public, et proche du Comité d'action des prisonniers. C’est dans cette perspective qu’il élabore sa généalogie du pouvoir de punir : se placer depuis les “anormaux” (les fous, les femmes, les dits “délinquants”) pour comprendre comment le pouvoir punitif se maintient et se reproduit, gagnant toutes les sphères de la vie et nous rendant acteur de notre propre servitude. Quelles sont alors les conditions d'émergence de la prison ? D'où vient la tentation répressive, celle de châtier, de punir, d’enfermer - de traquer et d’isoler l’illégalisme, le criminel, la marginalité ? D'où nous vient la catégorie de crime et de délinquance, et quel système (idéologique et économique) la prison justifie-t-elle ?
“Supplice”, première partie, 1757 : Robert-François Damiens est écartelé sur place publique pour avoir tenté d’assassiner Louis XV. C’est l’apogée du supplice, la spectacularité du châtiment : son corps est tenaillé, mutilé, découpé, avant d'être brûlé devant la foule. Un cérémonial punitif qui tend peu à peu à s’effacer : sans transition, Foucault met cette scène de mise en mort en perspective avec le règlement austère d'une prison de jeunes détenus, mis en place 75 ans plus tard. Soustrait au regard, l’'économie du châtiment, le "style pénal" se transforme : à l'exécution succède la privation de liberté, à la mise à mort succède la contrainte, la coercition. Le pouvoir admet qu’il peut se passer de la guillotine pour obtenir l’obéissance. Ainsi, la technologie et l'architecture carcérale a cela d’intrinsèque que la contrainte et la punition sont dissimulées derrière les murs, tout en s’érigeant comme menace archétypale pour qui dévierait de l’ordre pénal et économique. Un objectif alors : comment maintenir, penser le système pénitentiaire pour qu’il soit le plus rentable possible ?
Foucault s’intéresse alors au dispositif du panoptique, inventé par Jeremy Bentham : “L’effet du panoptique est d’induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. La surveillance est permanente dans ses effets, même si discontinue dans son action”. Le pouvoir disciplinaire obtient, en maintenant une surveillance continuelle, l’auto-discipline des individus : le corps n'est désormais plus mutilé pour manifester la puissance royale, mais dompté, surveillé, et mis au travail.
Une économie politique des corps, qui, selon Foucault, transcende les murs de la prison et quadrille, structure, organise la société : le pouvoir disciplinaire se diffuse, et l'assujettissement des individus est obtenu par une “microphysique du pouvoir” structurant nos rapports, de sorte que le corps comme outil de production est rendu le plus rentabl, le plus économiquement productif, et le plus obéissant possible. Au-delà de la prison, "La discipline ne peut s'identifier ni avec une institution ni avec un appareil ; elle est un type de pouvoir, une modalité pour l'exercer, comportant tout un ensemble d'instruments, de techniques, de procédés, de niveaux d'application, de cibles ; elle est une « physique » ou une « anatomie » du pouvoir, une technologie.”.
La prison du XIXème siècle telle que nous la connaissons n'est alors, pour Foucault, que la forme la plus spectaculaire de la société disciplinaire : l'école, l'hôpital, l'usine, sont autant d'institutions qui normalisent, répriment, surveillent l'individu-productif. Or, la tentation répressive nécessite l’apparition de la catégorie de crime : c’est la naissance de l’illégalisme, de la délinquance, de la déviance. Dans cette économie, le savoir est un pouvoir déterminant : il fonde l'autorité, délimite les normes et pénalise les conduites, justifiant un continuum répressif et disciplinaire.