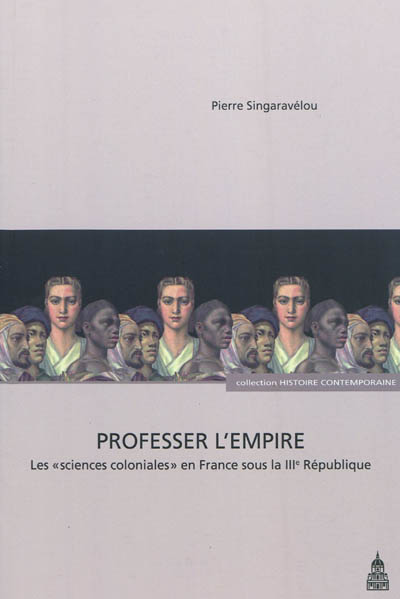en savoir plus

Carte fidélité
Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Wishlist
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Mes Alertes
Requiert un compte Mollat
Professer l'Empire : les sciences coloniales en France sous la IIIe République
Auteur : Pierre Singaravélou
en savoir plus
Résumé
Cette histoire sociale et intellectuelle des sciences dites coloniales sous la IIIe République analyse les structures qui favorisent leur enseignement et leur diffusion, en vue de la formation d'élites attachées au concept de mission civilisatrice de la France et à la popularisation de l'Empire. ©Electre 2025
Lire la Quatrième de couverture
Réduire la Quatrième de couverture
À partir des années 1880, la conjonction du scientisme et du renouveau de l'expansion ultramarine se traduit par l'institutionnalisation des savoirs sur les colonies et les populations colonisées, qui prennent la forme de nouvelles disciplines, les «sciences coloniales» («histoire et géographie coloniales», «législation et économie coloniales», «psychologie indigène»), enseignées dans les universités et les grandes écoles françaises. Les enseignants, universitaires et experts coloniaux, promeuvent une formation, tantôt pratique tantôt théorique, qui instruit les étudiants sur les colonies et justifie le projet impérial. Ces nouveaux spécialistes de la colonisation animent la «République des lettres coloniales», une nébuleuse d'associations, de sociétés savantes, de musées et de maisons d'éditions, spécialisés dans les questions coloniales. Toutefois cette adhésion du monde savant à la colonisation prend des formes très diverses, parfois contradictoires, irréductibles à un seul et même «discours colonial». L'objet colonial et le terrain ultramarin induisent un décentrement épistémologique conduisant les savants à élaborer de nouvelles méthodes et catégories d'analyse. La marginalité des savants coloniaux et leur polyvalence professionnelle les incitent à franchir les frontières disciplinaires en défrichant des domaines inédits - histoire orale, «colonisation comparée», science de l'aménagement, anthropologie juridique...
Dossiers
Fiche Technique
Paru le : 15/12/2011
Thématique : Histoire contemporaine générale
Auteur(s) : Auteur : Pierre Singaravélou
Éditeur(s) :
Editions de la Sorbonne
Collection(s) : Histoire contemporaine
Contributeur(s) : Préfacier : Christophe Charles
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-85944-678-9
EAN13 : 9782859446789
Reliure : Broché
Pages : 409
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 2.4 cm
Poids: 738 g