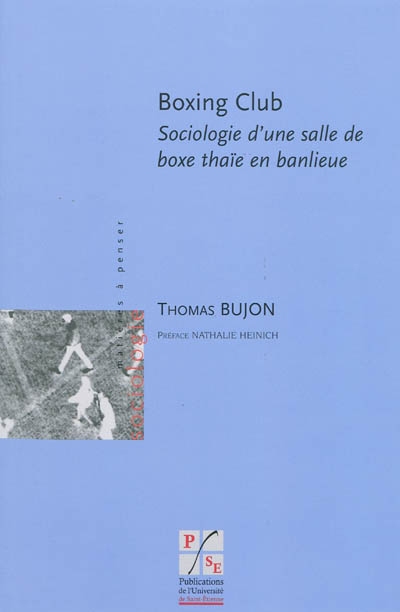en savoir plus

Carte fidélité
Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Wishlist
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Mes Alertes
Requiert un compte Mollat
Boxing club : sociologie d'une salle de boxe thaïe en banlieue
Auteur : Thomas Bujon
en savoir plus
Résumé
Issue d'une expérience ethnographique, cette étude a pour objet une monographie d'une salle de boxe dans une cité. A partir de sa propre expérience active, T. Bujon analyse des situations concrètes et aborde le sens de la justice et le moral des boxeurs, notamment en décrivant l'apprentissage de la boxe thaïlandaise réputée violente. Il fait appel à l'ethnométhodologie. ©Electre 2025
Lire la Quatrième de couverture
Réduire la Quatrième de couverture
La boxe a souvent fait les beaux jours de l'anthropologie urbaine. Elle a effectivement été une entrée privilégiée par les chercheurs pour observer la vie des quartiers pauvres et mal famés des grandes métropoles industrialisées. Dans la grande tradition de l'Ecole de Chicago, les monographies de salles de boxe ont fleuri tout au long de ces trente dernières années, donnant aux uns l'occasion d'observer les rapports que le monde de la boxe entretient avec le quartier et sa structure sociale ; aux autres d'explorer les liens entre le boxing business, l'expérience de la rue et celle du désoeuvrement.
En France, l'implantation très médiatisée des salles de boxe thaïlandaise dans les banlieues «chaudes» et l'exposition publique de ses champions «issus des quartiers» ont soulevé quelques craintes de la part des pouvoirs publics, principalement en raison de la «violence» générée par cette discipline pieds-poings et de l'horizon social qu'elle semble proposer aux «jeunes des cités». Il fallait donc voir les choses de plus près et enquêter sur la réalité sociologique de ce phénomène. Mais plutôt que de l'observer de l'extérieur, j'ai choisi de m'immerger par observation participante dans ce milieu de la boxe. A mon tour, j'ai décidé de m'inscrire dans une de ces salles de boxe, le Boxing Club, située en plein coeur d'une cité marquée par la précarité et l'isolement social. Sans rien révélé de la raison de ma présence sur les lieux aux boxeurs et aux dirigeants du club, j'ai appris les rudiments de la boxe «thaïe» : son vocabulaire technique, ses codes moraux et ses hiérarchies, ainsi que les règles de fonctionnement de ce milieu atypique. Cette étude se veut une microsociologie de la vie quotidienne de cette salle de boxe avec ses entraînements, ses combats et ses boxeurs. J'ai été l'un d'eux pendant un an. Et c'est de cette expérience ethnographique dont il est question dans cet ouvrage.
Fiche Technique
Paru le : 03/12/2008
Thématique : Sociologie de la culture
Auteur(s) : Auteur : Thomas Bujon
Éditeur(s) :
Presses universitaires de Saint-Etienne
Collection(s) : Matières à penser
Contributeur(s) : Préfacier : Nathalie Heinich
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-86272-533-8
EAN13 : 9782862725338
Reliure : Broché
Pages : 114
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 0.7 cm
Poids: 224 g