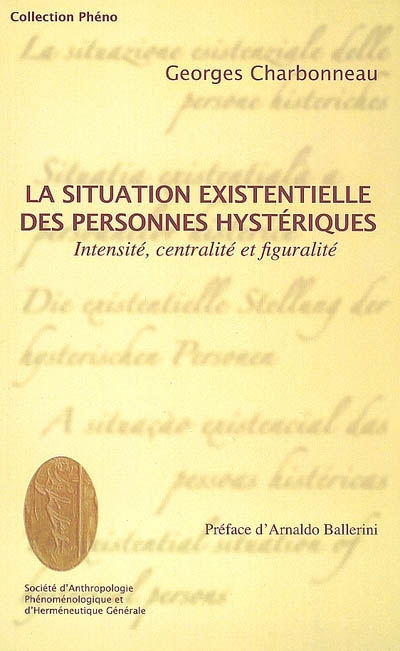en savoir plus

Carte fidélité
Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Wishlist
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Mes Alertes
Requiert un compte Mollat
La situation existentielle des personnes hystériques : intensité, centralité et figularité
Auteur : Georges Charbonneau
en savoir plus
Résumé
L'auteur propose de comprendre l'hystérie comme une position anthropologique, une situation existentielle : anthropologie phénoménologique, psychologie de l'hystérie, formalisme de la présence hystérique. Il s'agit de décrire une hystérie générale, ni féminine ni masculine, qui peut toucher tous les rôles humains et toutes les activités humaines : intensité, centralité et figularité. ©Electre 2025
Lire la Quatrième de couverture
Réduire la Quatrième de couverture
La perspective anthropologique sur l'hystérie se différencie profondément de celle, psychologique, que nous avons coutume d'emprunter. Elle évite deux écueils majeurs : tout d'abord d'aller trop vite aux contenus et de vouloir les interpréter un à un ; ensuite de se construire sur la seule hystérie féminine, ce que firent J.M. Charcot et S. Freud. Il en ressort alors une hystérie générale, ni féminine ni masculine. Elle veut décrire une situation hystérique qui peut toucher tous les rôles humains et toutes les activités humaines. N'en sont exempts ni la morale, ni le savoir ni la religion. Dès qu'il y a «grands airs», dès que l'homme se perd dans ces «grands airs», il y a de l'hystérie.
Cette voie anthropologique peut cerner l'hystérie comme une situation possible d'existence dans laquelle chacun peut être, transitoirement ou durablement, et surtout, de laquelle chacun aussi peut se défaire. Être, ici, n'a pas un sens ontologique mais anthropologique, celui de situation, de se tenir d'une certaine façon au regard d'une certaine totalité. L'hystérie n'engage pas notre être tout entier mais seulement nos identités de rôles et leurs représentations. Seules les psychoses jouent la teneur ontologique de notre être mais ce n'est pas ici notre question.
L'hystérie est une certaine situation d'existence, une relation particulière à la totalité marquée par trois déterminations : l'intensité, la centralité et la figuralité des représentations. L'homme dans l'hystérie, que ce soit celle du corps ou du champ social, fait une expérience de saturation d'intensité. Il recherche, accumule et accroît tout ce qui fait intensité. Il croit tenir dans l'intensité la matière de la vérité, comme dans l'expérience lyrique dont il recherche à tous moments l'ivresse. C'est aussi une pathologie de la relation à la centralité de l'espace intersubjectif. Il recherche au point de centralité le maximum d'intensité. Cette situation existentielle affecte aussi les représentations d'autrui, de soi, dans leurs rôles ; elles sont marquées à l'extrême par des typifications et une sorte d'extase figurale.
Cette anthropologie reste formelle et cela lui permet une certaine clarté et sobriété ; en matière d'hystérie, il n'en faut pas exiger moins.
Fiche Technique
Paru le : 01/09/2007
Thématique : Troubles du comportement - Généralités
Auteur(s) : Auteur : Georges Charbonneau
Éditeur(s) :
le Cercle herméneutique
Collection(s) : Phéno
Contributeur(s) : Préfacier : Arnaldo Ballerini
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-9523847-4-2
EAN13 : 9782952384742
Reliure : Broché
Pages : 144
Hauteur: 22.0 cm / Largeur 14.0 cm
Poids: 0 g