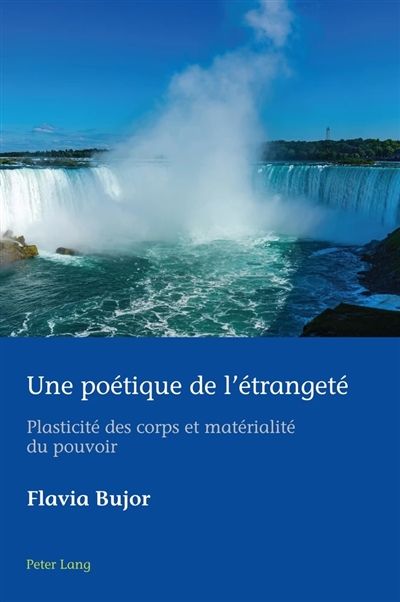en savoir plus

Carte fidélité
Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Wishlist
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Mes Alertes
Requiert un compte Mollat
Une poétique de l'étrangeté : plasticité des corps et matérialité du pouvoir
Auteur : Flavia Bujor
en savoir plus
Résumé
Thèse de doctorat sur la poétique de l'étrangeté et traitant de la manière dont le corps transparait dans les oeuvres de Suzette Mayr, de Marie NDiaye et de Yoko Tawada. Objet étrange qui ne semble plus naturel, le corps y est malléable et sujet à la métamorphose, marqué par la domination et le jeu des pouvoirs socio-économiques. Par la fiction, une nouvelle perception du monde émerge. ©Electre 2025
Lire la Quatrième de couverture
Réduire la Quatrième de couverture
European Connections
Studies in Comparative Literature, Intermediality and Aesthetics
La poétique de l'étrangeté est l'expression d'un retour au corps par lequel le roman contemporain interroge sa propre capacité à penser le monde social. Dans les oeuvres de Suzette Mayr, de Marie NDiaye et de Yoko Tawada, étudiées dans cet ouvrage, le corps apparaît comme un objet étrange, dont l'évidence naturelle ne va plus de soi. Il est caractérisé par sa malléabilité, voire par ses métamorphoses ; en même temps, il porte les marques des catégories de la domination. La poétique de l'étrangeté peut être interprétée comme une traduction littéraire du tournant théorique « matérialiste queer », qui s'efforce d'analyser ensemble la dynamique du pouvoir, fondée sur la production des subjectivités, et le caractère structurel de la domination, qui repose sur des bases socioéconomiques. Le corps est à la fois dénaturalisé et ressaisi comme le signe d'une histoire intersectionnelle. Il n'est pas tant l'expression d'une vérité de l'identité que la construction narrative d'un point de vue situé. C'est à partir d'un corps fictif que s'écrit une certaine perception du monde, que se redéfinissent les formes romanesques, et que se crée un usage étrange de la langue. Le dialogue entre la théorie et la fiction, qui prend source dans leur étrangeté réciproque, invite alors à imaginer la nature dénaturalisée du corps, tout comme la reconfiguration littéraire du monde social.
Fiche Technique
Paru le : 15/05/2023
Thématique : Essais et théories - Dictionnaire
Auteur(s) : Auteur : Flavia Bujor
Éditeur(s) :
P. Lang
Collection(s) : European connections
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-1-78997-965-7
EAN13 : 9781789979657
Reliure : Broché
Pages : XII-376
Hauteur: 23.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 2.0 cm
Poids: 0 g