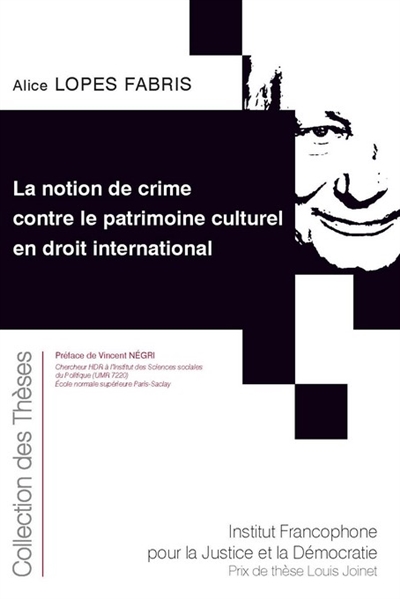en savoir plus

Carte fidélité
Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Wishlist
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Mes Alertes
Requiert un compte Mollat
La notion de crime contre le patrimoine culturel en droit international
Auteur : Alice Lopes Fabris
en savoir plus
Résumé
Mis en oeuvre au tournant du XXe siècle, le droit international relatif à la protection des biens culturels en cas de conflit armé s'est affermi à partir de 1945. Malgré les incriminations pénales établies par les statuts des juridictions internationales, le système de responsabilité demeure secondaire, comme le démontre l'auteure dans cette thèse. Prix de thèse Louis Joinet 2022. ©Electre 2025
Lire la Quatrième de couverture
Réduire la Quatrième de couverture
La notion de crime contre le patrimoine culturel en droit international
Depuis la Haute Antiquité jusqu'à nos jours, les récits des conquêtes militaires et des guerres, les archives et les matériaux documentaires pour les conflits contemporains tracent une même histoire adossée à la violence des crimes et des génocides : celle de la prédation de la culture des peuples vaincus et de la destruction du patrimoine. C'est à la charnière des XIXe et XXe siècles qu'une communauté d'États s'accorde pour Inscrire dans le droit international un principe d'immunité des monuments historiques et des oeuvres d'art en temps de guerre. Ils renforcent et généralisent une pratique qui a été progressivement instituée dans leurs relations et lors des guerres au long du XIXe siècle. Mais ce n'est que depuis 1945 que le droit international relatif à la protection des biens culturels en cas de conflit armé s'est affermi. Le système de responsabilité des auteurs de destructions demeure toutefois secondaire, malgré des incriminations pénales établies par les statuts de juridictions internationales. En plus, certaines formes violentes d'effacement de la culture que la doctrine a qualifié de génocide culturel, échappent à toute reconnaissance par les juridictions pénales. L'obligation de réparation suit un parcours juridique sinueux, marqué par des ambivalences de la notion de préjudice et de celle de victime. Les ajustements de ces notions en fonction des contextes culturels et sociaux demeurent embryonnaires et imparfaits, générant des mesures qui, localement, peuvent se révéler inadaptées pour réparer les dommages découlant de ces crimes. Le système de responsabilité, articulé sur des normes de prévention, sur des règles d'imputabilité, sur des concepts renouvelés de préjudice et de victime, et sur des linéaments d'une obligation de réparation, questionne les figures plurielles de la notion de crime contre le patrimoine culturel en droit international. L'analyse critique de la notion et de ces évolutions, ainsi que de la pratique internationale, révèlent une dynamique du droit international pour préserver le patrimoine culturel commun et la diversité culturelle de l'humanité.
Fiche Technique
Paru le : 20/12/2022
Thématique : Droit international
Auteur(s) : Auteur : Alice Lopes Fabris
Éditeur(s) :
Institut francophone pour la justice et la démocratie
Collection(s) : Collection des thèses
Contributeur(s) : Préfacier : Vincent Négri
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-37032-366-8
EAN13 : 9782370323668
Reliure : Broché
Pages : XVI-666
Hauteur: 25.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 3.7 cm
Poids: 1102 g