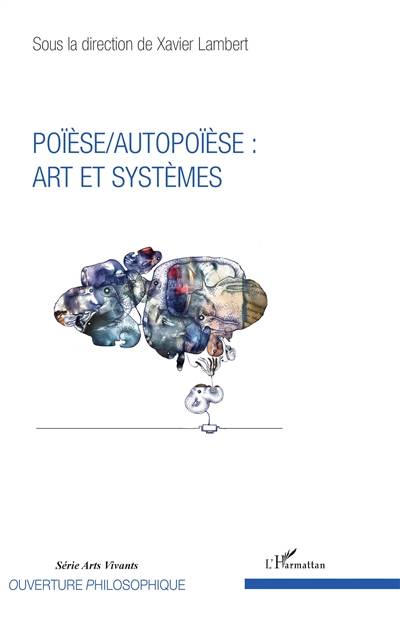en savoir plus

Carte fidélité
Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Wishlist
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Mes Alertes
Requiert un compte Mollat
Poïèse-autopoïèse : art et systèmes
en savoir plus
Résumé
Une réflexion sur la relation entre les arts contemporains et les technologies du numérique en particulier sur la façon dont ces technologies interrogent les processus de création artistique et réciproquement comment les démarches artistiques interrogent les enjeux conceptuels et sociétaux de ces technologies. ©Electre 2025
Lire la Quatrième de couverture
Réduire la Quatrième de couverture
Cet ouvrage a pour vocation d'explorer une dimension particulièrement féconde de la relation entre les arts contemporains et les technologies actuelles, et, tout particulièrement, les technologies du numérique. Il se propose de construire une réflexion sur la façon dont ces technologies interrogent spécifiquement les processus de création artistique et, réciproquement, comment les démarches artistiques, dans la singularité de chacune, interrogent les enjeux conceptuels et sociétaux de ces technologies. Le propos est de mettre en articulation le concept de poïèse et celui d'autopoïèse. La poïèse renvoie à l'idée de faire, fabriquer (de poieien, faire). Dans le domaine artistique, la poïèse correspond au processus d'effectuation de l'oeuvre. Cela comprend autant les processus mentaux mis en oeuvre dans le processus, que la transformation de la matière (ou de l'énergie) qui résulte de ces processus, et les allers-retours dialectiques que suppose nécessairement ce dispositif. L'autopoïése définit, littéralement, ce qui se fait soi-même. Initié par Varela, notamment, le concept d'autopoïèse définit les systèmes vivants. Il est utilisé aussi pour définir les systèmes informatiques de type génératif qui ont une capacité d'évolution autonome, d'évolution par apprentissage. La création artistique contemporaine est de plus en plus concernée par la question de l'autopoïèse, soit parce qu'elle utilise des programmes génératifs, soit parce qu'elle utilise les systèmes vivants (manipulations génétiques, cultures de tissus...) soit, enfin parce que les représentations du réel qu'induit le concept d'autopoïèse sont une donnée paradigmatique qui préside en tant que telles à un certain nombre de démarches qui ne reposent pas nécessairement sur l'utilisation de ces technologies. L'hypothèse est que l'utilisation des systèmes autopoïétiques dans le cadre d'une démarche artistique décentre le rapport de l'artiste à l'oeuvre dans sa poïèse puisqu'il ne se situe plus dans une logique de représentation du réel mais de présentation (de production ?) de réel. L'artiste reste concepteur, mais délègue la poïèse à un dispositif systémique processuel. La question est de savoir alors s'il y a transformation ontologique de la posture de l'artiste par rapport au processus poïétique, et, par-delà, comment cette posture continue d'inscrire sa singularité par rapport au système lui-même.
Fiche Technique
Paru le : 26/10/2017
Thématique : Généralités Histoire de l’Art
Auteur(s) : Non précisé.
Éditeur(s) :
L'Harmattan
Collection(s) : Ouverture philosophique
Contributeur(s) : Directeur de publication : Xavier Lambert
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-343-13202-0
EAN13 : 9782343132020
Reliure : Broché
Pages : 308
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.7 cm
Poids: 485 g