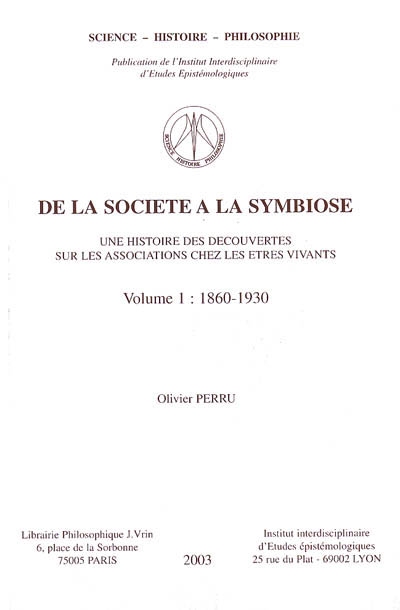en savoir plus

Carte fidélité
Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Wishlist
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Mes Alertes
Requiert un compte Mollat
De la société à la symbiose : une histoire des découvertes sur les associations chez les êtres vivants. Vol. 1. 1860-1930
Auteur : Olivier Perru
en savoir plus
Résumé
Cet ouvrage s'intègre dans un programme de recherche historique sur la notion de symbiose et ses champs d'expérience et d'application en biologie. Il tente de remonter aux origines de diverses recherches sur la symbiose et de leur environnement historique et épistémologique. ©Electre 2025
Lire la Quatrième de couverture
Réduire la Quatrième de couverture
Une histoire des découvertes sur les associations chez les êtres vivants
Faire l'histoire des découvertes relatives aux associations chez les êtres vivants suppose de considérer les deux points de départ historiques que sont, au dix-neuvième siècle, l'étude des sociétés de vivants, et l'étude de l'organisme vivant. Les sociétés de vivants, en particulier les sociétés d'insectes, sont étudiées dès le début du siècle (Latreille) et, vers 1878, Espinas s'efforce de distinguer les associations interspécifiques de la formation d'une société, en utilisant le critère du concours mutuel. Des travaux des zoologistes des années 1840-1860, émergent divers concepts comme la division du travail en vue de mieux comprendre la formation de l'organisme.
En 1875, Pierre-Joseph Van Beneden distingue le mutualisme et le commensalisme du parasitisme et trois ans plus tard, en lien avec les travaux de Frank sur les lichens, Anton de Bary définit la symbiose. Cela permet de distinguer la symbiose lichénique du parasitisme et d'intégrer dans la symbiose les diverses catégories du "vivre ensemble" sans la réduire à une forme étroite de mutualisme. Les découvertes des algues symbiotiques chez les animaux invertébrés marins (Geddes, Brandt, Hertwig, Le Dantec, Famintsyn, vers 1880-1890) permettent de préciser la nature de la relation symbiotique en vue de la nutrition d'un animal. La connaissance de ces algues, de leur degré de dépendance et d'autonomie, permettra d'élaborer une première théorie d'évolution par la symbiose. Vers 1910, Mereschkowsky sera pratiquement le premier à imaginer une cyanophycée comme ancêtre du chloroplaste. Par ailleurs, tout un débat se focalisera autour de l'oeuvre de Portier, Les Symbiotes, et du rapport possible entre mitochondries et bactéries.
Les années 1920 voient la disparition progressive de théories jugées abstraites ou idéologiques, du fait du progrès des connaissances expérimentales. Avec le début de l'oeuvre de Paul Buchner (1930), les relations symbiotiques sont désormais décrites précisément et systématisées en fonction des grands domaines de la zoologie. De plus, en particulier aux Etats-Unis, les années 1930 semblent sonner le glas de travaux sur la symbiose et l'évolution, du fait de la montée en puissance de la génétique morganienne.
Fiche Technique
Paru le : 24/11/2003
Thématique : Biologie
Auteur(s) : Auteur : Olivier Perru
Éditeur(s) :
Vrin
Institut interdisciplinaire d'études épistémologiques de Lyon
Collection(s) : Science, histoire, philosophie
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782711683796
Reliure : Broché
Pages : 286
Hauteur: 25.0 cm / Largeur 17.0 cm
Épaisseur: 1.8 cm
Poids: 800 g