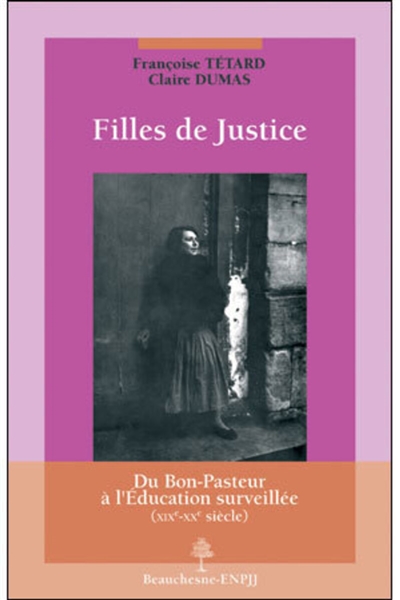en savoir plus

Carte fidélité
Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Wishlist
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Mes Alertes
Requiert un compte Mollat
Filles de justice : du Bon-Pasteur à l'éducation surveillée, XIXe-XXe siècle
Auteur : Françoise Tétard
Auteur : Claire Dumas
en savoir plus
Résumé
L'étude, consacrée à la délinquance féminine chez les mineures aux XIXe et XXe siècles, évoque la prise en charge de ces jeunes femmes entre prisons, quartiers correctionnels, maisons pénitentiaires et écoles de préservation. ©Electre 2025
Lire la Quatrième de couverture
Réduire la Quatrième de couverture
Les filles de Justice, décidément, sont bien embarrassantes. Depuis deux siècles, elles ont été sans cesse transférées de prisons en quartiers correctionnels, de maisons pénitentiaires en écoles de préservation. Confinées derrière une clôture. Qui sont-elles ? Qu'ont-elles fait ? Des mineures qui, pour diverses raisons, sont passées devant un juge. Elles ne sont pas forcément délinquantes, mais elles seraient susceptibles de l'être ; elles ne sont pas forcément prostituées, mais elles seraient au bord de l'être. Toujours considérées comme difficiles, voire vicieuses.
L'État se sentant impuissant s'est déchargé sur les congrégations religieuses et leur a «confié» la rééducation de ces filles, sous forme d'une mission de service public. La congrégation Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur d'Angers, déjà spécialisée dans les filles perdues, a ainsi acquis un monopole. Contre des prix de journée versés par l'État, elle les a reçues au milieu d'autres femmes et adolescentes, pensionnaires de tous âges. Cette situation a perduré sous la IIIe République, au moment du vote des lois de 1901 et de 1905, en plein conflit entre confessionnels et laïques. Un scandale cependant vient éclabousser la réputation de la congrégation quand, à Nancy, l'évêque entre en conflit avec la supérieure ; il s'ensuit un procès qui se solde par la fermeture en 1903 du Bon-Pasteur de la ville.
Cet ouvrage a pour fil conducteur l'histoire d'un de ces établissements, ouvert en 1839, à Bourges (Cher). Un hectare, en plein centre ville, un îlot hors du temps. En 1966, une mère supérieure éclairée commence à moderniser la maison lorsqu'elle reçoit l'ordre de procéder à la vente du patrimoine. L'acquéreur en est le ministère de la Justice qui cherche le lieu idéal pour expérimenter des pédagogies auprès des filles dans le secteur public. Comment s'est réalisé ce passage du monde religieux à la culture laïque ? D'autres établissements du Bon-Pasteur ont connu le même sort et, à partir des années 1960, ont progressivement lâché ce qui constituait leur identité. Pourquoi, après avoir résisté si longtemps ?
Fiche Technique
Paru le : 21/04/2009
Thématique : Droit Pénal
Auteur(s) : Auteur : Françoise Tétard Auteur : Claire Dumas
Éditeur(s) :
Beauchesne
Collection(s) : Enfance hors la loi
Contributeur(s) : Editeur scientifique (ou intellectuel) : Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (France)
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7010-1538-5
EAN13 : 9782701015385
Reliure : Broché
Pages : 483
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 4.0 cm
Poids: 790 g