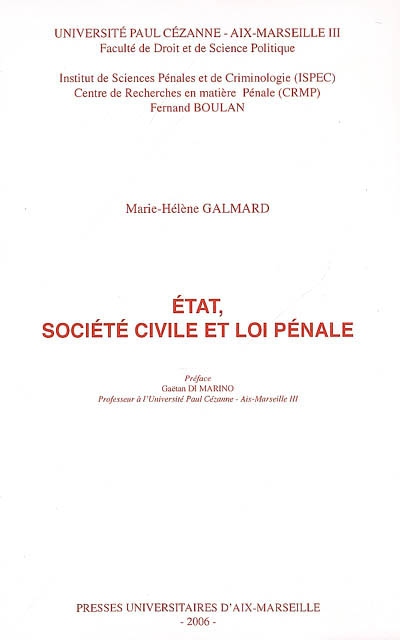en savoir plus

Carte fidélité
Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Wishlist
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Mes Alertes
Requiert un compte Mollat
Etat, société civile et loi pénale
Auteur : Marie-Hélène Galmard
en savoir plus
Résumé
L'analyse de la reconfiguration actuelle des liens entre l'Etat et la société civile à travers la création de la loi pénale met en évidence un double mouvement d'interpénétration entre eux, mouvement qui vient remettre en question l'idée d'une scission entre la sphère publique et la sphère privée, toujours présente dans notre Constitution. ©Electre 2025
Lire la Quatrième de couverture
Réduire la Quatrième de couverture
La création de la loi pénale peut être qualifiée de prérogative régalienne à un double titre. D'un point de vue formel, elle relève, comme pour toute autre loi, de la compétence du Parlement, organe étatique chargé d'exprimer la volonté générale de la nation, en vertu du mécanisme de la représentation institué en 1789. Sous un angle matériel, elle s'inscrit pleinement dans la mission fondamentale de l'Etat qui consiste à assurer le maintien de l'ordre public et de la paix sociale. Pourtant, l'examen des exposés de motifs des projets et propositions de lois pénales déposés au cours de ces dernières années, montre que parmi les raisons invoquées au soutien de l'intervention du législateur, les attentes de la société civile constituent un argument récurrent et, bien souvent, déterminant. Celles-ci sont identifiées à travers les notions «d'opinion publique» et de «groupes d'intérêts», au moyen de divers procédés (sondages, résultats électoraux, lobbying...) dont la plupart n'ont pour objet qu'une fraction seulement de la population française et sont empreints de subjectivité. Ne permettant pas globalement, de retranscrire fidèlement les aspirations de l'ensemble des citoyens, ces mécanismes ne peuvent être analysés comme des techniques de démocratie directe ou semi-directe. Leur étude révèle néanmoins, qu'ils exercent aujourd'hui une influence considérable sur le processus de création de la loi pénale, conférant ainsi à la société civile, un rôle inédit. Ce nouveau mode de fonctionnement, qui consiste pour le législateur à associer certains membres de la société civile à son oeuvre, a des répercussions sur les qualités intrinsèques et extrinsèques de la loi pénale. De moins en moins rare, générale, permanente, obligatoire, claire et systématique, elle s'éloigne progressivement de sa représentation théorique et se pose actuellement le problème de son effectivité. Dès lors, il semble aujourd'hui opportun de s'interroger sur les moyens de mettre en harmonie la loi pénale telle qu'elle existe dans la réalité avec son modèle, en lui permettant de jouer son véritable rôle.
Fiche Technique
Paru le : 10/01/2007
Thématique : Droit professionnel - Institution judiciaire
Auteur(s) : Auteur : Marie-Hélène Galmard
Éditeur(s) :
Presses universitaires d'Aix-Marseille
Collection(s) : Collection du Centre de recherches en matière pénale Fernand Boulan
Contributeur(s) : Editeur scientifique (ou intellectuel) : Institut de sciences pénales et de criminologie (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) - Préfacier : Gaëtan Di Marino
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7314-0563-7
EAN13 : 9782731405637
Reliure : Broché
Pages : 404
Hauteur: 25.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 645 g