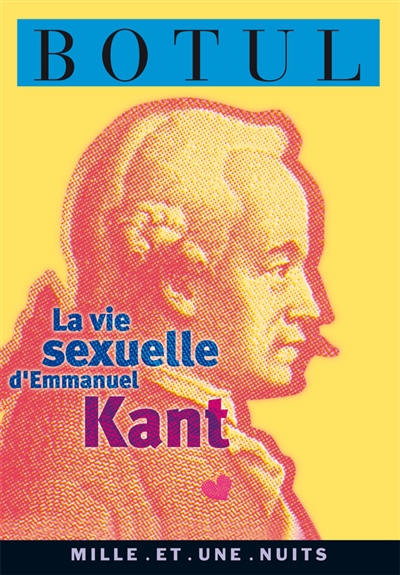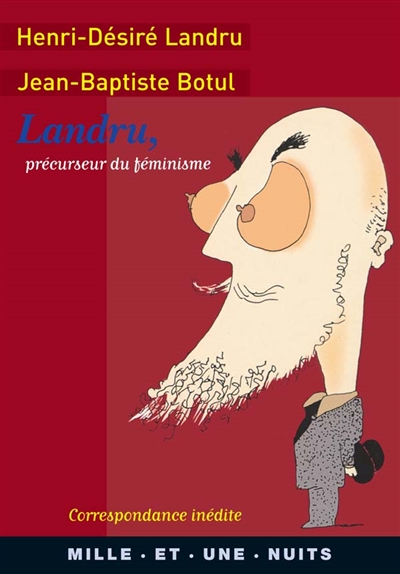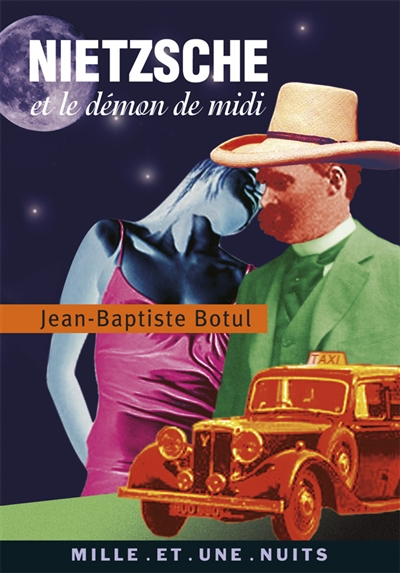Nietzsche ou le démon de midi retranscrit la plaidoirie que J.-B. Botul prononça, pour sa défense, devant le tribunal professionnel des taxis parisiens. Le 5 janvier 1937 au soir, une cliente mineure monta dans le taxi de Botul et lui indiqua une adresse aux résonances équivoques : « Cours Désir ». Et pour couronner cette hardie entrée en matière, la jeune femme révéla son prénom : Héloïse. La course en taxi qui s'ensuivit se mua une suspecte virée dans la nuit parisienne qui ne fut pas au goût des parents d'Héloïse. Au tribunal, J.-B. Botul se défendit d'avoir attenté à l'honneur de la jeune Héloïse : « je n'ai pas imité le grand Abélard. Ce qui me fait espérer que vous n'imiterez pas ses bourreaux et ne me ferez pas subir le même traitement… » Le philosophe reconnut néanmoins avoir connu la tentation et, pour s'expliquer, il dressa un parallèle entre sa rencontre avec Héloïse et la rencontre de Nietzsche avec Lou Andréas-Salomé. Botul prétendit avoir été, à l'instar de l'illustre moustachu, victime d'un « daïmon » : le démon de midi. Sa plaidoirie ne sut pas convaincre les membres du jury qui, presque tous, piquèrent du nez à mesure que l'exposé avançait vers le petit matin. Botul fut finalement radié des taxis parisiens (ce qui ne l'empêcha pas de se féliciter d'avoir été ce jour-là, pour la première fois, écouté « la bouche ouverte » par son auditoire). Anecdote à part, l'édition de la plaidoirie botulienne offre une analyse savante et savoureuse de la philosophie nietzschéenne et de son irrémédiable naufrage dans les bras de la démonique Lou.
Landru, précurseur du féminisme est la correspondance entre J.-B. Botul et Henri-Désiré Landru, « le monstre de Gambais ». En 1919, lorsque la presse se fait l'écho de l'affaire Landru, J.-B. Botul est étudiant à la Sorbonne. Il se souvient que, trois ans auparavant, il a fait la connaissance de l'accusé dans un restaurant montmartrois. Le courrier qu'il lui adresse inaugure la correspondance que les deux hommes entretiennent jusqu'à l'exécution de Landru, en 1922. Botul ne tient pas Landru pour le monstre sanguinaire que la justice s'apprête à condamner. Il voit plutôt en lui le grain de sable dans le mécanisme machiste huilé par la tradition. Botul innocente Landru des crimes qui lui sont reprochés : certes les victimes présumées ont bel et bien disparu mais Landru ne les a manifestement pas assassinées. Voici, en substance, l'analyse de l'affaire que J.-B. Botul adresse à Landru :
Dans la France du début du XXème siècle, la femme « juridiquement dépendante de son mari ivrogne, moralement dans les mains boudinées de son confesseur et quotidiennement soumise à des enfants ingrats […] demeure une femme enfant, que les hommes voient comme une première communiante attardée. » Il semble qu'elle ait fini par se persuader elle-même qu'elle n'a pas d'existence hors le giron de son maître mâle. Pour les femmes qui venaient trouver refuge entre ses bras, Landru prenait le masque du prince charmant salvateur dont était empli leur imaginaire asservi. Il était l'idéal masculin tant recherché ("compte tenu de votre physique, écrit Botul à Landru, cela peut réconforter beaucoup d'hommes sur les opportunités qu'il leur reste à exploiter"). Puis, dans une brutale volte-face, Landru leur révélait la vacuité de leur relation, la vérité de leur condition : ces femmes humiliées, violemment ébranlées dans leurs convictions, n'avaient d'autres choix que de fuir leur identité bafouée, disparaître à l'étranger peut-être, pour renaître à une nouvelle vie. Agitateur excitant les vélléités féministes qui couvent dans la gent féminine, libérateur de la femme : voilà, selon Botul, le véritable Landru.
Le style et la pensée de J.-B. Botul provoquèrent quelquefois des troubles de la respiration dans le milieu universitaire parisien des années 1930. L'impertinence du botulisme autant que la "botul attitude", un tant soit peu farfelue et provocatrice, valurent à l'énergumène d'être taquiné par des propos méprisants, des plaisanteries charcutières. On sut rappeler que le botulisme, avant de désigner la philosophie de Jean-Baptiste Botul, désigne une intoxication alimentaire due, notamment, à l'ingestion de charcuterie avariée. Puis le philosophe sombra dans un obscur anonymat, d'où on peine à le sortir aujourd'hui encore.
Il faut reconnaître que J.-B. Botul, qui prit grand soin de faire disparaître les traces écrites de son travail, fut lui-même le principal artisan de son absence à la postérité. De son oeuvre, on ne connaît donc pas grand chose aujourd'hui. De sa vie, qui fut celle d'un infatigable globe-trotter, guère davantage...