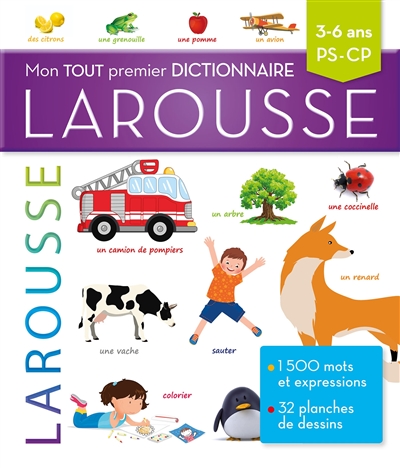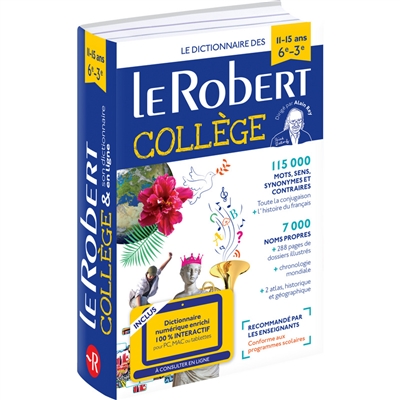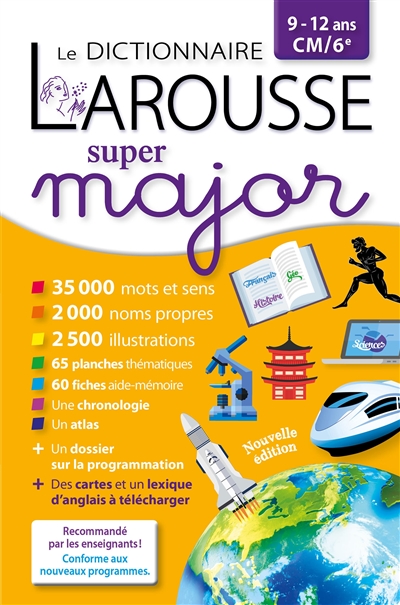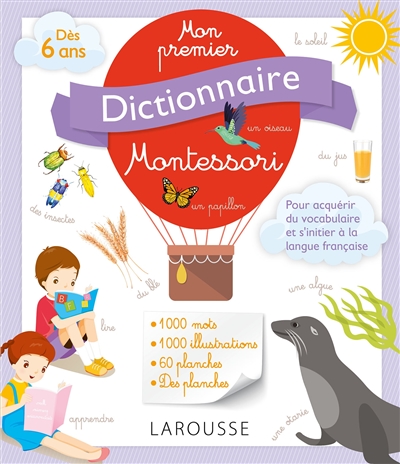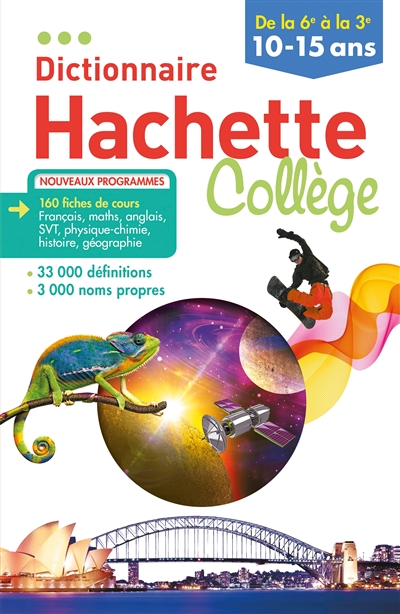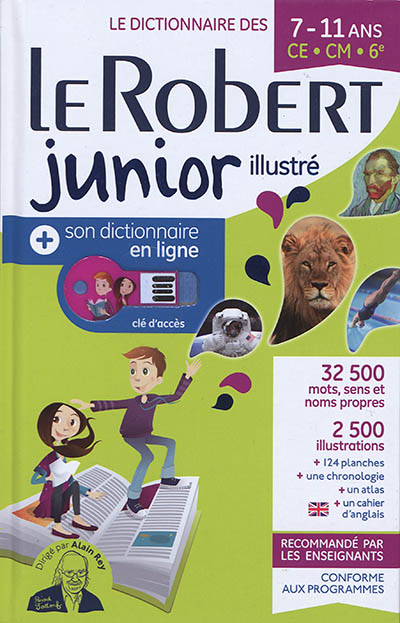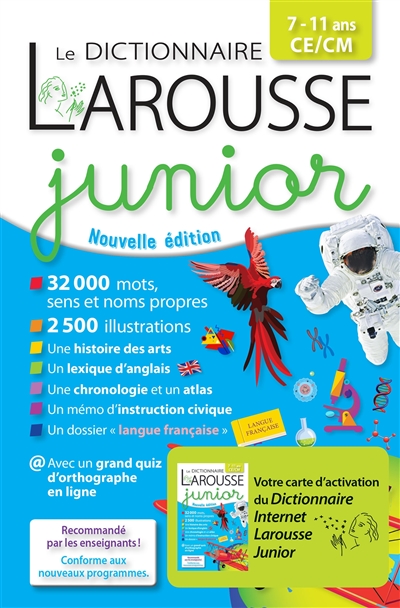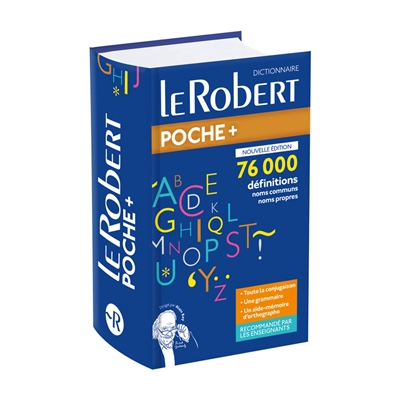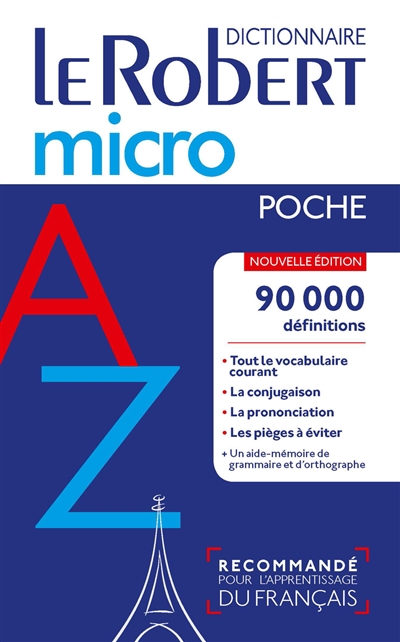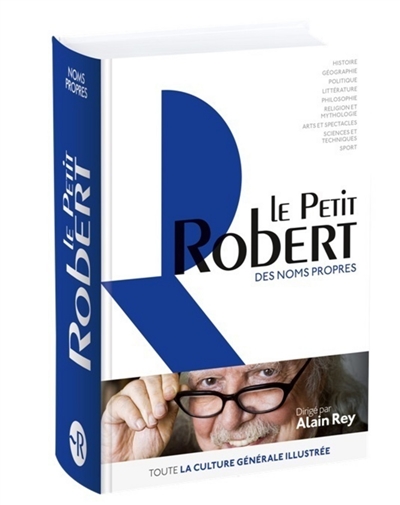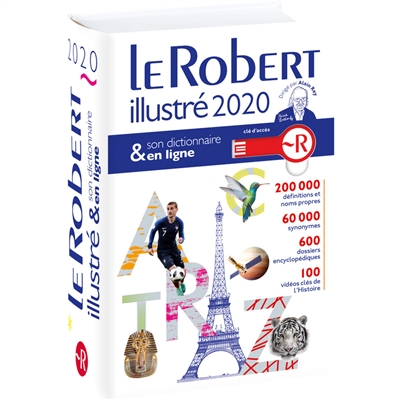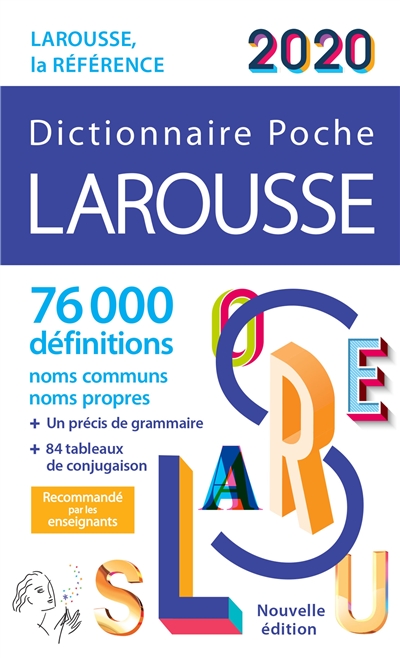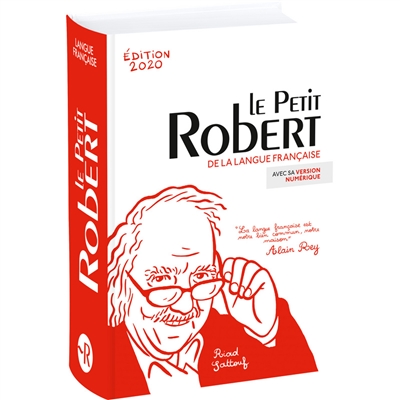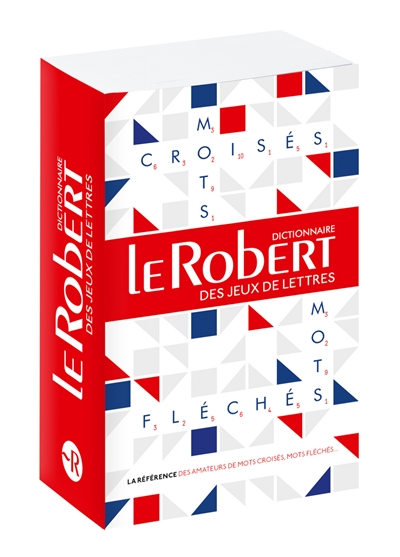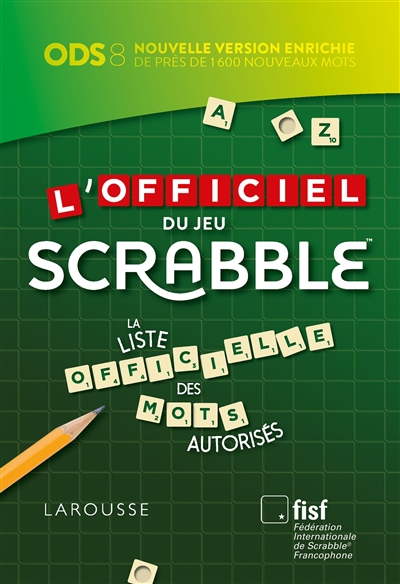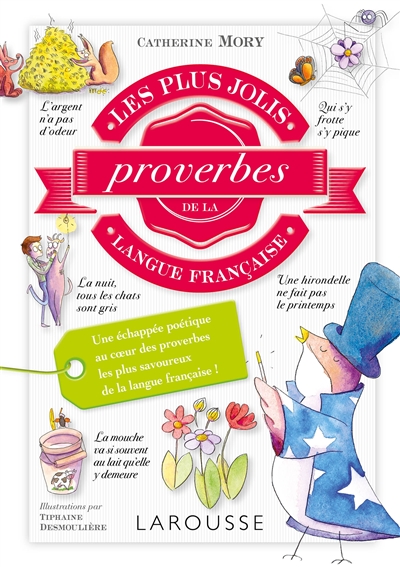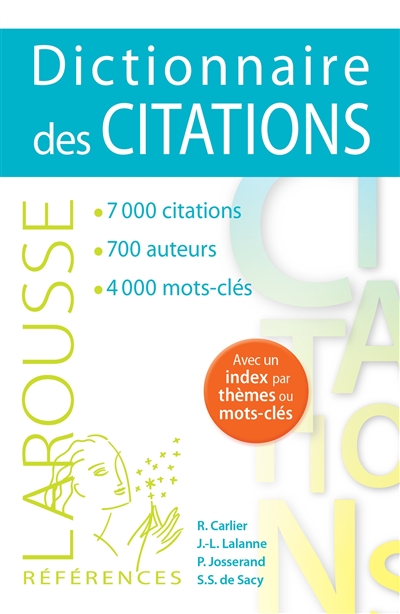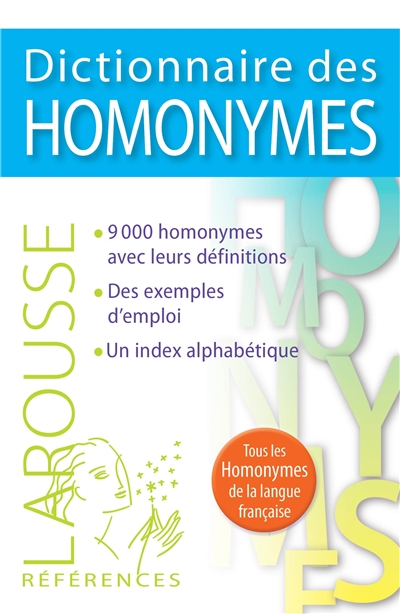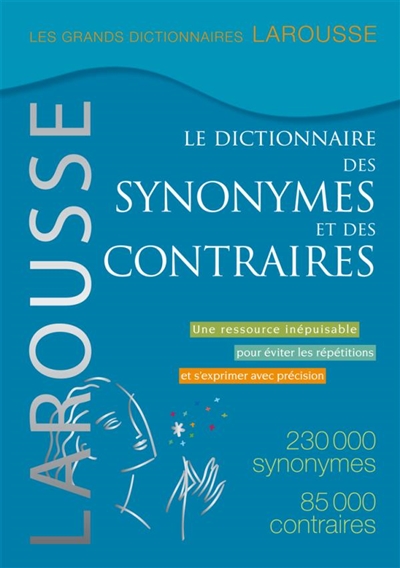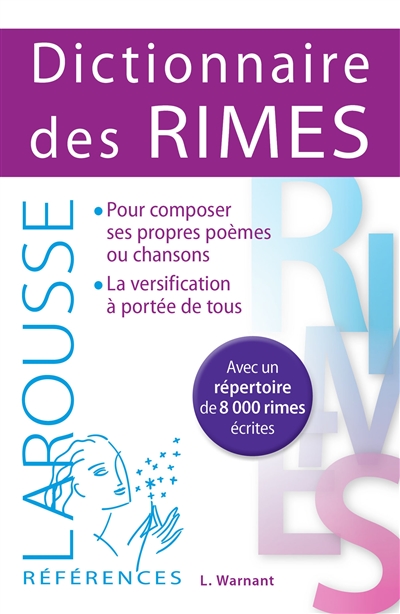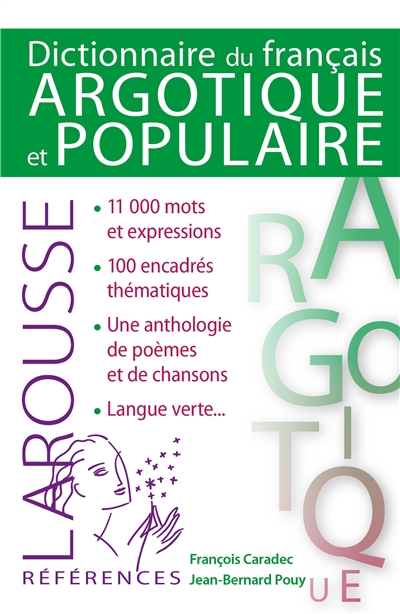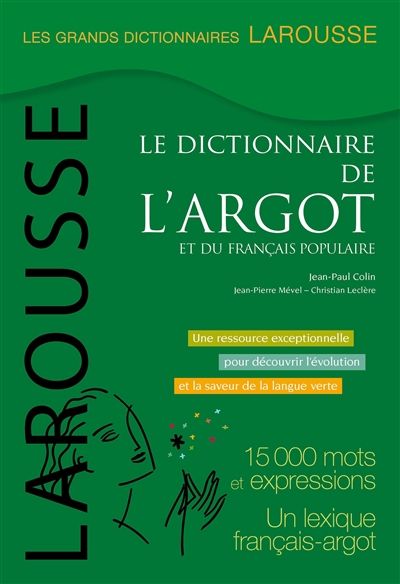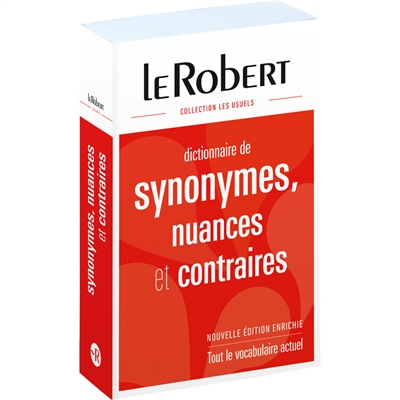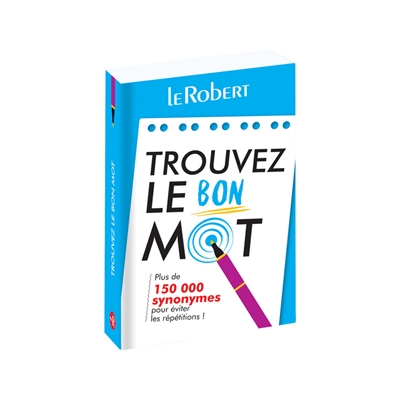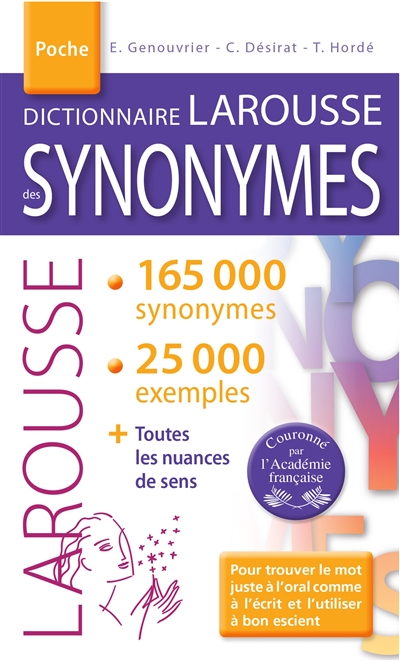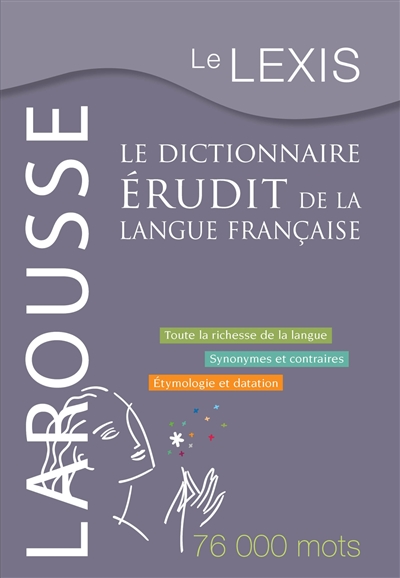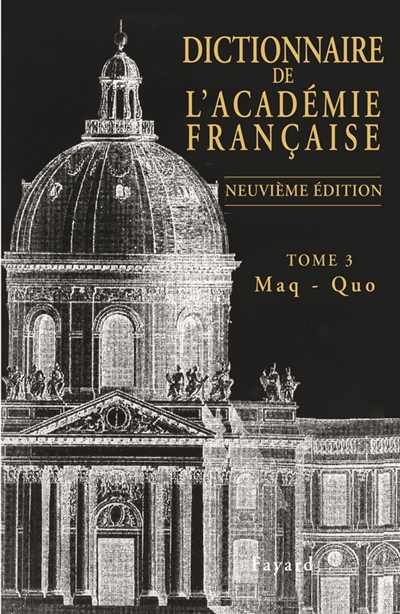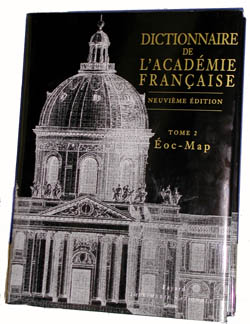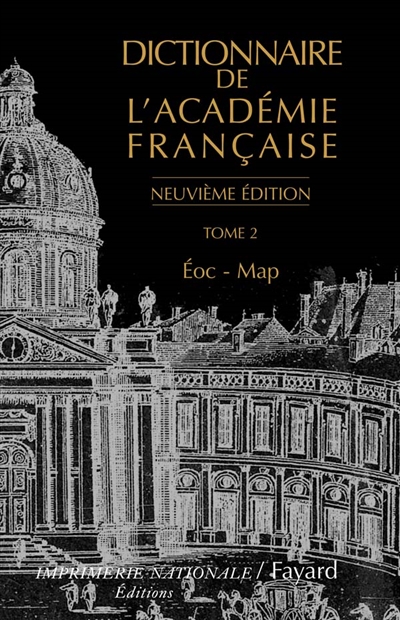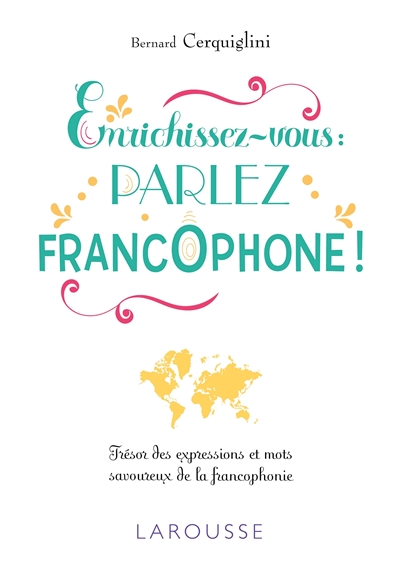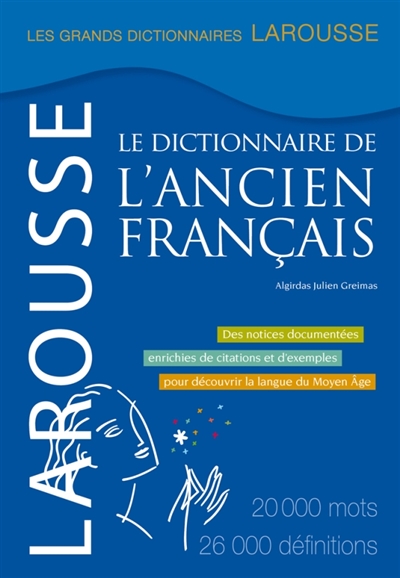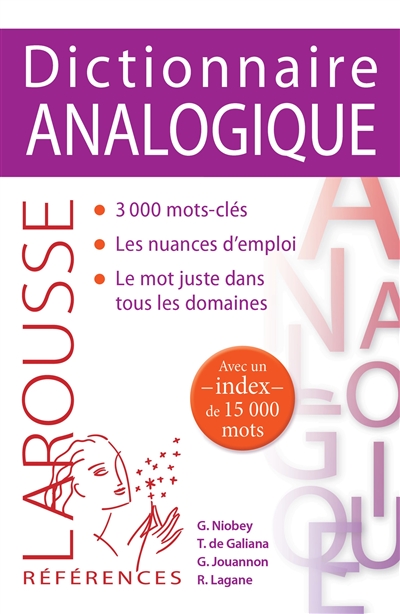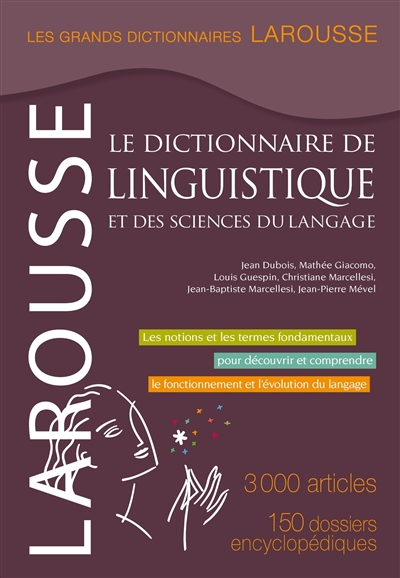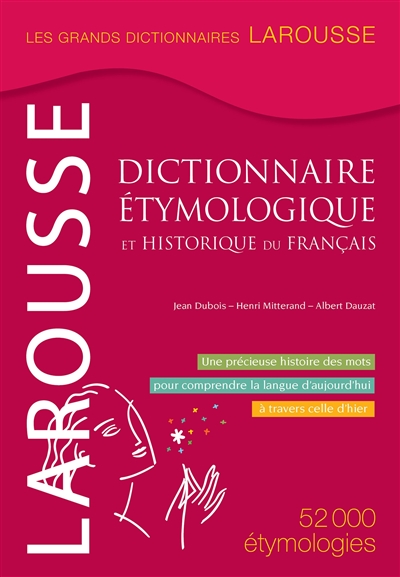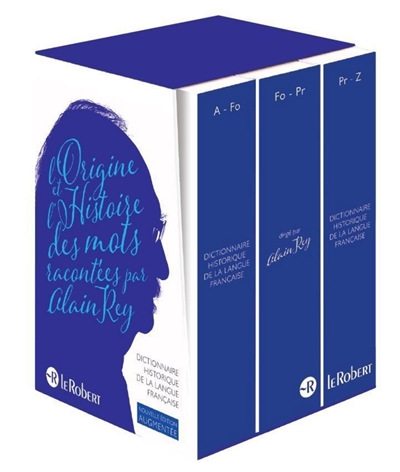Chargement...
Chargement...
Bien choisir son dictionnaire
Une actualité de
Libraires
Publié le 02/04/2020
Ouvrage de référence scolaire, familial, culturel ou professionnel, le dictionnaire de
langue française peut représenter un investissement. Pour bien le, voire les, choisir,
il est essentiel de savoir à quel usage on le destine.
À ce jour, deux grandes maisons d’édition se partagent la majorité de l’offre en terme
de dictionnaires, Le Robert et Larousse. Du dictionnaire lexicographique à
l’étymologique, en passant par les dictionnaires des synonymes, scolaires ou
analogiques, ces ouvrages compilent des informations répondant à des objectifs
souvent distincts, sinon complémentaires : sens/définition, orthographe,
phonétique, usages, niveaux de langue, synonymes, antonymes, étymologie,
sémantique… Inutile donc d’acquérir un dictionnaire extrêmement riche si on a
besoin d’un outil familial !
Dans la grande majorité des cas, le dictionnaire recherché est celui dit d’usage
comme Le Petit Robert ou le Larousse illustré. Afin d’en faciliter l’appropriation aux
plus jeunes, plusieurs ouvrages ont été réalisés en fonction des âges et des tranches
de scolarité. Les illustrations sont ainsi majoritaires dans les « premier
dictionnaire » pour favoriser l’apprentissage de la lecture. Les éditeurs proposent
ensuite des ouvrages pour l’école maternelle, élémentaire et le collège comprenant
des univers sémantiques en corrélation avec les programmes. Le niveau d’éducation
des lycéens leur permet d’utiliser pertinemment les dictionnaires d’usage
classiques.
Pour des raisons pratiques, les éditions de poche sont parfois privilégiées. Elles
restent cependant moins précises. Le nombre de mots référencés donne un repère
même s’il reste difficile de connaître précisément le nombre de ceux composant la
langue française. L’Académie française, dans la 9 e version de son dictionnaire
comptera 55 000 entrées, Le Grand Larousse en affiche 63 500, alors que le Lexis
intègre 76 000 mots. Les versions destinées aux enfants enrichissent la sphère
lexicale au fur et à mesure de la scolarité. La disparité s’explique notamment par les
usages répertoriés : courant, littéraire, spécialisé, régionalisme, voire francophonie.
Certains comptent aussi des noms propres, particulièrement utiles pour un usage de
culture générale.
S’il est toujours bon d’avoir un dictionnaire à portée de main, la majorité des
éditions proposent aujourd’hui une version numérique couplée à l’achat de
l’ouvrage papier. Elles sont précisées par les mentions « bimédia », « clé en ligne »
ou « dictionnaire internet ».
Pour les étudiants, selon le cursus choisi, l’orientation vers des références lexicales
spécifiques se fera en concertation avec leurs enseignants. Les littéraires auront
intérêt à compléter leur bibliothèque par des dictionnaires plus pointus tel le Lexis,
voire des précis étymologiques ou linguistiques… Ces registres seront partagés par
les professionnels de la langue française afin d’en préciser ou d’en apprécier la
justesse : niveaux de langue, précision et enrichissement du vocabulaire,
associations sémantiques, emplois historiques.
Enfin, les amateurs de jeux de lettres, cruciverbistes avertis et passionnés de
Scrabble trouveront des dictionnaires adaptés. Méthodes de recherche et contenus
ont été pensés selon les spécificités des jeux.
Pour la scolarité
Usage courant, familial et jeux de lettres
Usages spécifiques et précis
Dictionnaire du français argotique et populaire
Auteur : François Caradec
Éditeur : Larousse
13,95 €
Pour les amoureux et spécialistes de la langue
Dictionnaire de l'Académie française. Vol. 3. Maq-Quo
Auteur : Académie française
Éditeur : Fayard
100,00 €
Dictionnaire de l'Académie française. Vol. 1. A-Enz
Auteur : Académie française
Éditeur : Fayard
75,00 €
Dictionnaire de l'Académie française. Vol. 2. Eoc-Map
Auteur : Académie française
Éditeur : Fayard
30,50 €
Grand dictionnaire étymologique & historique du français
Auteur : Jean Dubois
Éditeur : Larousse
20,50 €